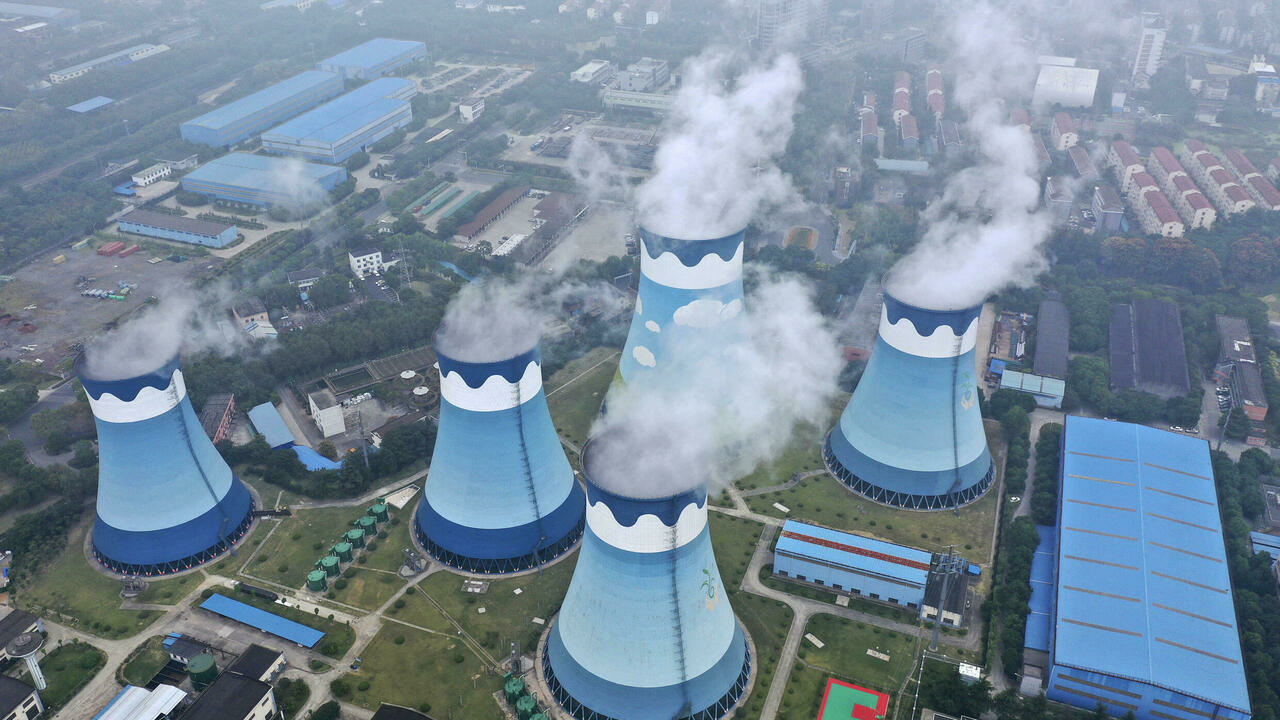Mayyu Ali fait partie des quelque 700 000 Rohingyas qui ont dû fuir la Birmanie à l’été 2017 face aux exactions commises par l’armée birmane. Cinq ans plus tard, ce poète de 31 ans continue d’écrire pour porter la voix de son peuple.
“La Terre tourne autour de deux mondes bien différents ; l’enfer et le paradis. J’ai quitté l’un pour découvrir l’autre.” Il y a un an, en septembre 2021, Mayyu Ali écrivait ses quelques mots en passant la porte de son nouvel appartement, dans l’Ontario, au Canada, avec sa femme et sa petite fille. La fin d’un long calvaire pour ce poète rohingya de 31 ans après quatre ans passés dans le plus grand camp de réfugiés du monde, celui de Cox’s Bazar, au Bangladesh.
Hasard du calendrier ou clin d’œil du destin, le 6 septembre prochain, cinq ans jour pour jour après avoir quitté la Birmanie – comme 700 000 autres Rohingyas – afin de fuir les persécutions de l’armée, il prendra le chemin de l’université pour étudier la littérature engagée. Son objectif, poursuivre une mission qu’il s’est donnée dès l’adolescence : se faire le porte-parole de sa communauté et raconter son histoire. À son actif, il compte déjà des dizaines de poèmes publiés et, plus récemment, une autobiographie en français, “L’Effacement” (Éditions Grasset), coécrite avec la journaliste Émilie Lopes. “Les discriminations, la fuite, les violences… j’ai tout vu et tout vécu. Il est de mon devoir de le raconter au monde entier”, résume-t-il simplement.
“Pour le gouvernement birman, je n’existe pas”
Mayyu Ali est né en 1991 à Maungdaw, dans l’Arakan, une région birmane au bord de l’océan Indien. Fils de pêcheur, dernier d’une fratrie de six enfants, il aime se rappeler “une enfance joyeuse”, bercée par des baignades dans la rivière et de jeux avec ses amis bouddhistes ou hindous.
“Mais la joie s’est rapidement transformée en peur”, témoigne-t-il. Depuis une loi sur la citoyenneté adoptée en 1982, les Rohingyas, à majorité musulmane, sont apatrides, considérés par la Birmanie comme des migrants illégaux venus du Bangladesh. Un statut qui en fait la cible d’exactions de l’armée et d’extrémistes religieux bouddhistes. “Un jour, alors que j’avais une dizaine d’années, des militaires ont fait une descente chez tous les Rohingyas de mon quartier. Y compris chez moi”, raconte-t-il. “Ils avaient une arme à la main, c’était terrifiant. C’est là que j’ai eu le déclic : quand j’ai appris qu’ils n’étaient pas allés chez mes amis bouddhistes ou hindous, j’ai compris que nous étions victimes de discrimination.
Dans les années qui suivent, la liste des injustices auxquelles sa famille et ses amis sont confrontés paraît sans fin. “Mon frère a été battu puis jeté en prison parce qu’il n’avait soi-disant pas payé une taxe liée à la construction de sa maison, on a confisqué les terres de mon grand-père. Autour de moi, des gens ont été empêchés de travailler sans raison”, énumère-t-il.
En 2010, Mayyu Ali se voit interdit de poursuivre des études d’anglais à l’université à cause de son appartenance ethnique. Initié à la poésie par son professeur d’anglais au lycée, il s’était pris de passion pour Shakespeare et pour l’auteur indien Rabindranath Tagore. L’adolescent à l’esprit revanchard, qui écrivait jusqu’alors en secret et pour le plaisir, commence à s’y mettre plus sérieusement.
“Au début, j’écrivais beaucoup sur la nature, l’amitié, la famille…”, explique-t-il, retrouvant immédiatement le sourire à l’évocation de son métier. “Et puis, peu à peu, j’ai compris qu’écrire pouvait être un acte de rébellion. Je suis rohingya. Pour le gouvernement birman, je n’existe pas. Je suis un être humain sans citoyenneté, sans droits. Mais quand j’écris, j’existe et ma communauté aussi.”
Au moment où les exactions contre les Rohingyas se renforcent dans l’Arakan en 2012, le jeune homme se lance le défi de publier ses textes qu’il rédige en anglais ou en birman. Quelques mois plus tard, c’est la consécration : un de ses poèmes apparaît dans un magazine littéraire birman anglophone. “Je l’ai vécu comme une renaissance. Tout d’un coup, je suis devenu une personne reconnue, avec un nom.”
“Cette année-là a été un tournant”, explique-t-il. “Les Rohingyas ont toujours été discriminés, mais, désormais, l’objectif des autorités était de nous faire disparaître”, dénonce-t-il. Il se souvient de violentes émeutes, d’incendies meurtriers, des premiers villages détruits et des premières fuites de population vers le Bangladesh voisin. Lui reste, mais décide de s’engager auprès d’associations, notamment Action contre la faim, pour venir en aide à la population.
Un travail de collecte
Jusqu’à cette nuit du 25 août 2017. “Je vivais alors à Maungdaw, à deux heures de bus de chez mes parents. Je dormais quand ma mère m’a appelé”, raconte-t-il. “En pleurs au téléphone, elle m’a expliqué que des militaires avaient mis le feu au village. Tout était détruit.” Dans les jours qui suivent, il assiste à ce qu’il qualifie de “nettoyage ethnique”. “Il y avait de la fumée partout, des balles sifflaient, on entendait des cris, des femmes se faisaient violer”, témoigne-t-il, ému.
Comme 750 000 autres Rohingyas, Mayyu Ali et sa famille se résignent à fuir au Bangladesh voisin. Trois jours de marche et un fleuve à traverser. “Il a fallu nager au milieu des cadavres, dans ce fleuve dans lequel je jouais enfant”, se souvient-il. Aujourd’hui encore, chaque 25 août, les Rohingyas commémorent ces jours de violence.
Réfugié dans ce qui est devenu le plus grand camp de réfugiés du monde, Cox’ Bazar, à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, Mayyu Ali continue d’écrire. Mais ses vers prennent désormais une autre dimension. Au-delà de la poésie, il veut garder en mémoire tout ce qu’il voit. Fort de son travail auprès d’associations humanitaires et de journalistes qu’il guide au milieu des abris de fortune, il recense des centaines de témoignages. “J’ai tout noté dans des carnets. Les petites filles violées, les meurtres, la corruption, la faim, les conditions sanitaires déplorables”, poursuit-il. “Et j’espère qu’un jour cela servira à rendre justice.”
À cause de cet engagement, le poète est menacé de mort part des milices armées au sein du camp. “Il a fallu que je me cache pendant plusieurs mois”, raconte-t-il. “Mais c’est aussi grâce à cela que j’ai pu quitter le Bangladesh. Les associations se sont mobilisées pour m’offrir une porte de sortie.”

Faire vivre à tout prix la culture rohingya
Un an plus tard, si Mayyu Ali a pu rejoindre le Canada, il retourne chaque jour, par les échanges avec ses proches, dans les camps de Cox’ Bazar. “Mes parents, mes frères et sœurs sont restés là-bas”, explique-t-il. “Ils me disent que les conditions se dégradent mois après mois. Il y a de plus en plus d’insécurité. À chaque intempérie, les abris sont détruits. Les maladies prolifèrent”, dénonce-t-il.
Selon Médecins sans frontières (MSF), les cas de dysenterie ont augmenté de 50 % par rapport à 2019 dans les camps et les cas d’infections cutanées, comme la gale, explosent. Les Rohingyas s’inquiètent également de l’augmentation de la criminalité. Une centaine de meurtres ont été commis en cinq ans, selon un décompte établi par l’AFP. Parmi les victimes, des chefs communautaires probablement ciblés par des vendettas d’insurgés. Les jeunes, sans perspectives d’avenir, n’ont pas le droit de sortir des camps ni de travailler. De leur côté, pour désengorger les camps, les autorités bangladaises ont fait transférer quelque 30 000 réfugiés sur Bhashan Char, une île au large du golfe de Bengale.
Alors le jeune écrivain reste mobilisé pour apporter son aide. Quand il ne milite pas auprès de la communauté internationale pour faire reconnaître le “génocide” de son peuple, il travaille d’arrache-pied pour donner accès à l’éducation à des enfants de Cox’ Bazar, qui sont parfois nés dans l’enceinte de ces camps de fortune. “Certains enfants sont là depuis cinq ans, autant de temps pendant lequel ils ont été privés d’éducation. Je refuse que ce soit une génération sacrifiée”, martèle-t-il. Avec des associations locales, il est parvenu à mettre en place deux écoles où les élèves étudient le programme scolaire birman. “Si un jour, par miracle, ils retournent en Birmanie, ils pourront retourner à l’école”, salue Mayyu Ali.
“Quand on parle du massacre des Rohingyas, on pense aux exactions et aux violences physiques. Mais on s’attaque aussi à notre culture et à notre langue”, dénonce-t-il. “En étant réfugiés, on perd notre ancrage culturel. Il faut se battre contre ça. Si notre culture survit, notre ethnie aussi.”
Le reste du temps, Mayyu Ali continue à le consacrer à sa passion et à noircir des pages. “Je veux continuer à écrire, être publié dans plusieurs pays pour continuer à me battre pour les miens et inciter la communauté internationale à agir”, termine-t-il. En mars 2022, les États-Unis ont été les premiers à reconnaître un “génocide” des Rohingyas perpétré par l’armée birmane. Et pour le poète de conclure avec ses vers : “Un peuple, depuis des décennies, pour être une minorité musulmane, demeure encore et toujours sous la lame et les balles. Encore et toujours oppressé, encore et toujours violé et emprisonné. Encore et toujours brûlé et terrifié. Ah ! Quelle violence !”