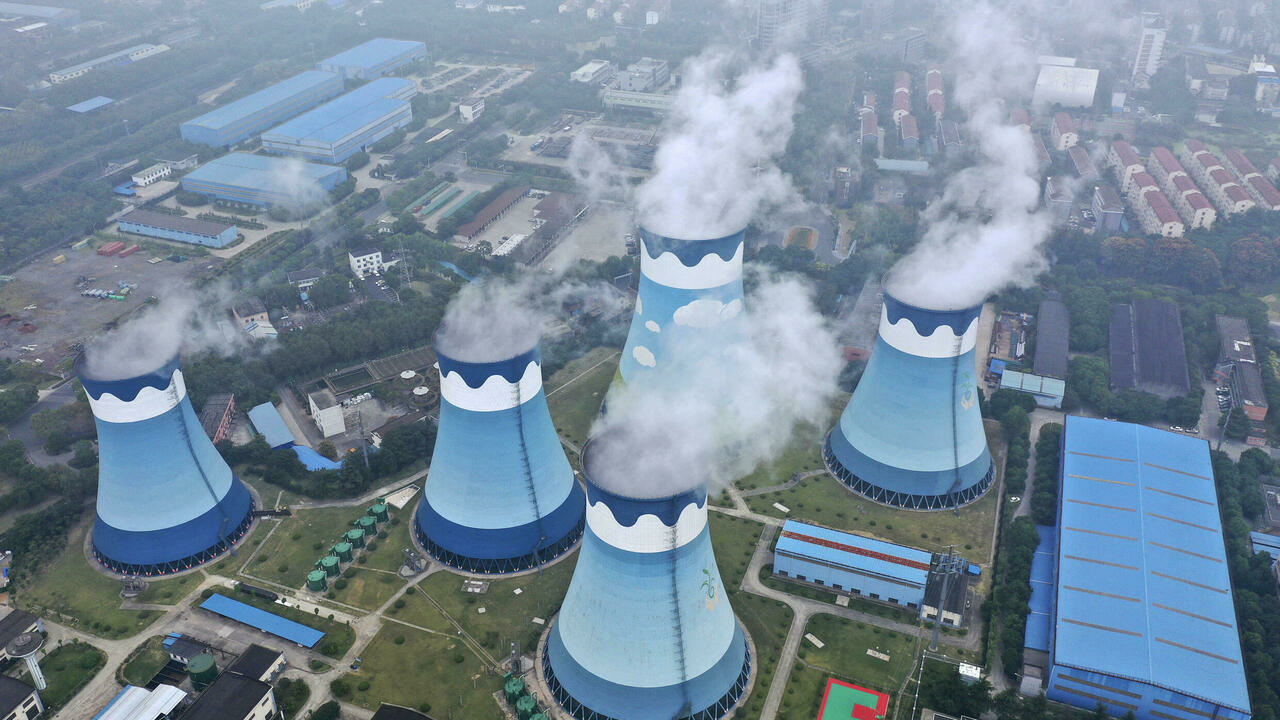Les États membres de l’ONU sont réunis jusqu’au 26 août pour une cinquième session de négociations qui devraient aboutir à un traité international pour la protection de la haute mer. À l’heure actuelle, ces eaux internationales, pourtant essentielles à la survie de millions d’espèces dont l’espèce humaine, ne disposent pas de cadre juridique. Depuis 2018, les discussions patinent sur plusieurs points sur lesquels les États membres espèrent cette fois trouver des compromis.
Elle s’étend sur près de la moitié de la planète mais ne bénéficie toujours d’aucune protection. La haute mer, qui représente 64 % des océans, fait de nouveau l’objet de négociations à l’ONU, à New York, depuis lundi 15 août. L’objectif des États membres : aboutir à un traité international visant à protéger ces eaux profondes qui regorgent de biodiversité et constituent un énorme puits de carbone.
La haute mer commence là où s’arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE – bandes de mer ou d’océan situées entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur lesquelles les États riverains disposent de l’exclusivité d’exploitation des ressources). Située à 200 miles nautiques des côtes maximum, soit 370 km, la haute mer n’est, elle, placée sous la juridiction d’aucun État.
Dans sa résolution 72/249 du 24 décembre 2017, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé de convoquer une conférence intergouvernementale afin d’élaborer le texte d’un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
De plus en plus menacées par les activités humaines, les eaux internationales ont longtemps été ignorées au profit de la protection des zones côtières. Aujourd’hui, l’intensification de la pollution, de la surpêche, du réchauffement des océans dû au changement climatique, ou encore de l’exploitation minière et pétrolière rend la prise de décision de plus en plus impérieuse. Mais plusieurs intérêts sont en jeu et les négociations patinent.
Au large, la situation est préoccupante :
- D’après les estimations de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la part des stocks de poisson exploitée à un niveau biologiquement non durable est passée de 90 % en 1974 à 65,8 % en 2017 ; la part exploitée à un niveau non durable est, elle, passée à 34,2 % contre 10 % en 1974.
- 90 % du commerce mondial passe par le transport maritime en haute mer. Des collisions surviennent souvent entre les navires colossaux qui sillonnent l’océan et les mammifères marins.
- Les bateaux sont également à l’origine d’une pollution maritime. Plusieurs tonnes de filets destinés à attraper un grand nombre de poissons ont été retrouvés. Des déchets auxquels s’ajoutent divers plastiques rejetées par des navires toujours plus nombreux. Retrouvés en haute mer, ces déchets sont si nombreux et denses qu’ils pourraient recouvrir les territoires de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne réunis.
Selon la Fondation Ellen MacArthur, près de 8 millions de tonnes de plastique polluent les écosystèmes marins chaque année. Les experts estiment que dans trente ans, il y aura plus de déchets que de poissons dans l’océan.
- Les opérations d’exploration visant à extraire cobalt, cuivre et nickel soulèvent la crainte de la destruction d’écosystèmes uniques.
Présidente de la conférence, la Singapourienne Rena Lee a appelé à un maximum de flexibilité pour parvenir à un accord juste et équilibré qui permette une participation universelle et puisse être mis en œuvre. L’enjeu est de taille mais un consensus peine à émerger. “Le texte révisé reflète des points de vue largement divergents sur les principales dispositions”, explique sur Twitter Glen Wright, chercheur en gouvernance international de l’Océan à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Aussi, rappelle-t-il, “les États restent entièrement libres d’approuver ou de rejeter les dispositions du projet, ainsi que de proposer des amendements et un nouveau texte”.
Dissensions sur les ressources génétiques marines
Après deux années d’interruption à cause du Covid-19, le quatrième rendez-vous, en mars dernier, devait être le dernier. Mais malgré des avancées, les négociateurs avaient manqué de temps pour s’entendre sur un compromis couvrant les quatre axes majeurs de cet accord : les ressources génétiques marines (RGM), les études d’impact sur l’environnement, la gestion et la protection de la biodiversité et le renforcement des capacités de transfert de technologies.
“Il y a une fracture entre pays en développement et pays développés”, explique Klaudija Cremers, chercheuse en politique maritime internationale à l’Iddri, évoquant notamment la question des ressources génétiques maritimes.
Alors que les minéraux des fonds marins situés au-delà de la juridiction nationale (comme le cobalt) sont considérés comme le “patrimoine commun de l’humanité” (ce qui signifie qu’ils doivent être exploités et conservés pour le bénéfice de tous), les pays en développement soutiennent que cela s’applique aussi aux ressources génétiques marines.
Ces ressources (d’origine végétale, animale ou microbienne), dont regorgent les zones situées au-delà de la juridiction nationale (ZAJN), sont prisées pour leurs propriétés génétiques et biochimiques et peuvent être exploitées pour la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques. La haute mer étant considérée comme un bien commun, aucun État n’est propriétaire de ces ressources.
Mais à l’heure où les négociations tentent d’établir des règles pour assurer que les bénéfices venant de l’exploitation et de l’extraction des RGM soient partagés de manière équitable, les intérêts des pays en développement s’opposent à ceux des pays développés. “Les pays en développement attendent des bénéfices monétaires, alors que les pays développés veulent, eux, développer des aspects non monétaires, notamment via les transferts de technologies”, précise Klaudija Cremers.
Dans le compte rendu de la deuxième journée de négociations, mardi, le Earth Negotiations Bulletin (service d’information indépendant sur les négociations des Nations unies en matière d’environnement et de développement), rapporte les options proposées pour restructurer le texte. “Certains ont souligné que le partage des avantages devait être obligatoire, y compris les éléments financiers et non financiers, le tout devant être partagé équitablement (…) Une délégation a souligné que les modalités du partage des avantages monétaires devraient être réglementées dans le cadre de l’accord et ne pas être laissées à la future Conférence des Parties (COP). Un groupe régional a suggéré d’ajouter, comme avantage non monétaire, une coopération scientifique accrue.”
Ambitions disparates sur les aires marines protégées
Des dissensions s’expriment aussi sur les outils de gestion par zone, en particulier les aires marines protégées (AMP). Ces espaces délimités en mer répondent à des objectifs de protection de la biodiversité marine qui favorisent la gestion durable des activités maritimes.
Par exemple, la France, deuxième zone économique exclusive (ZEE) au monde avec plus de 10 millions de kilomètres carrés (avec l’outre-mer) dispose de 524 aires marines protégées, couvrant près de 32 % de sa ZEE.
L’idée du traité est d’élargir ce principe aux eaux internationales. La mise en place d’aires marines protégées est même l’une des mesures phares de conservation de la biodiversité marine. Si le traité voit le jour, 30 % des océans deviendront des zones protégées.
D’après la FAO, 90 % des stocks mondiaux de poissons sont épuisés ou pleinement exploités. Or, une grande partie de cette pêche a lieu en haute mer. Les AMP pourraient rendre la pêche plus durable en permettant aux espèces de reconstituer leurs populations dans des zones interdites aux activités industrielles.
Aujourd’hui, il existe quelques AMP situées en haute mer. Le traité actuellement discuté vise à introduire des mesures juridiquement contraignantes pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les eaux internationales afin de restreindre les activités humaines et de renforcer la lutte contre la pollution. En effet, il est impossible de contraindre juridiquement des États à appliquer un accord s’ils n’en sont pas partie.
Mais ici encore, la recherche d’un compromis est nécessaire. “Certains pays veulent donner beaucoup de pouvoir au traité pour créer des AMP, quand d’autres, plus conservateurs, préfèrent le statu quo et veulent que les organisation professionnelles existantes qui gèrent la pêche soient responsables de toutes les activités pratiquées dans ces AMP”, explique Klaudija Cremers, évoquant des divergences d’avis sur la mise en place de telles mesures.
Concernant les études d’impact sur l’environnement (EIE), il n’existe pas de base pour les activités humaines en haute mer, rappelle-t-elle. Sur ce sujet, reste à définir qui des États ou de la future Conférence sur climat (COP 27 prévue du 7 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte, NDLR) sera chargé de réaliser les EIE, et à quel moment nous avons besoin d’une EIE. “Si l’EIE dit qu’on ne peut pas réaliser une activité sans avoir d’impact sur l’environnement, quelle sera l’étape suivante ?”, questionne la chercheuse, indiquant des avis divergents sur un sujet qui peut aussi bien concerner la pêche que l’exploitation des fonds marins pour le cobalt ou pour la transformation énergétique.
À New York, “l’atmosphère est optimiste”
En ce qui concerne le renforcement des capacités et transfert de technologies marines, “la Convention des Nations unies sur le droit de la mer parle beaucoup du développement des capacités, mais la mise en œuvre n’a pas été à la hauteur de l’ambition”, estime Glen Wright, ajoutant que les pays en développement demandent plus de soutien afin de pouvoir participer efficacement à la conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine.
“Les pays en développement se battent pour que le traité impose aux pays développés de contribuer financièrement pour les aider à développer des activités humaines en haute mer”, ajoute Klaudija Cremers.
“L’atmosphère à New York est optimiste”, note Klaudija Cremers qui se rendra sur place avec son collègue Glen Wright, pour suivre la deuxième semaine des négociations. “Beaucoup de pays poussent pour finaliser cet accord”, ajoute-t-elle, évoquant une “coalition de pays de haute ambition” menée par l’Union européenne et notamment la France qui, après avoir accueilli le One Ocean Summit à Brest en février dernier et assuré la présidence du Conseil de l’UE de janvier à juin, veut s’imposer comme un moteur de ces négociations internationales.
C’est ainsi que, lundi et mardi, le secrétaire d’État français à la Mer, Hervé Berville, appuyait la haute ambition de la France et de l’UE, renouvelée en juin à la Conférence des Nations unies pour l’océan, organisée à Lisbonne.
L’équilibre de notre planète est lié à celui de l’océan, bien commun que nous devons préserver. C’est cet engagement français d’aboutir à un accord ambitieux dès 2022 que je suis venu porter lors de la négociation du traité @UN pour la protection de la biodiversité marine #BBNJ pic.twitter.com/YDDSCAlUE3
— Hervé Berville (@HerveBerville) August 17, 2022
Selon Klaudija Cremers, une cinquantaine de pays soutiennent cette coalition de haute ambition. À ce jour, “tous les États, même ceux réticents au départ car actifs sur la pêche veulent trouver des compromis”, ajoute-t-elle, évoquant notamment la Chine, la Norvège, l’Islande ou encore les États-Unis. “Seule la Russie continue de bloquer les négociations”, affirme la chercheuse, évoquant des relations dégradées du fait de la guerre en Ukraine.
Quelles conséquences, alors, si un accord est trouvé mais qu’un État ne le ratifie pas ? “Les États non membres [de l’ONU] ou qui n’ont pas ratifié l’accord n’ont pas l’obligation de suivre ce qui y est inscrit”, répond la chercheuse en politique maritime internationale. Ce qui ne signifie pas qu’en pratique, les États non-parties ne respectent pas pour autant l’esprit du texte, conclut-elle, prenant l’exemple des États-Unis, non-signataires de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (en raison d’un désaccord sur l’exploitation des fonds marins), mais qu’ils respectent et dont la question de l’adhésion se pose régulièrement depuis l’entrée en vigueur du texte, en 1994.
Dès les années 1980, avec la Convention de Montego Bay, la division des espaces maritimes en zones (ZEE, haute mer) s’opère mais sur une logique de ressources marines infinies, pouvant être utilisées sans fin, rappelle Klaudija Cremers. C’est seulement en 2002, dit-elle, que l’ONU commence à parler de la nécessité de protéger la haute mer.
Il aura ensuite fallu du temps pour qu’un mandat de l’ONU se penche sur la création d’un instrument juridique véritablement contraignant. “C’est pour cette raison que ce traité est important. Cela concerne tous les pays du monde et ce n’est pas juste un objectif de développement durable (ODD) : tout État qui ratifiera l’accord sera obligé de l’appliquer”.