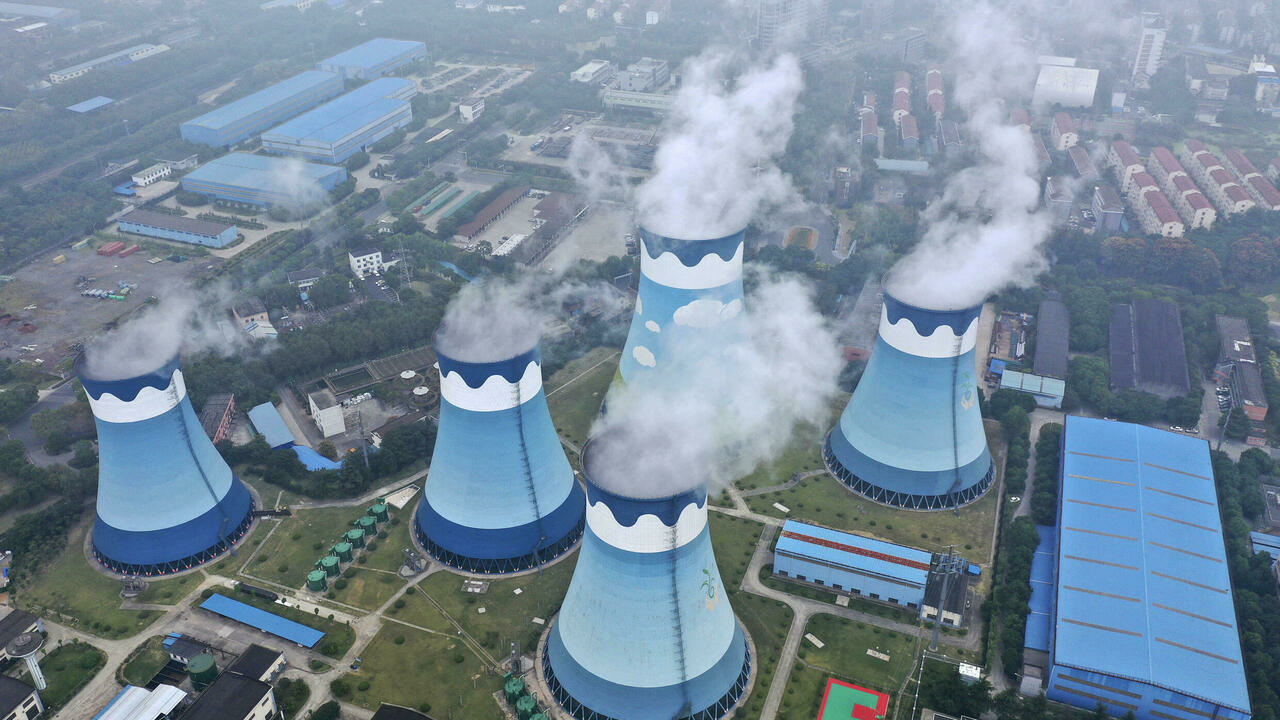Situé à quelques centaines de mètres du port de Beyrouth, le quartier défavorisé de Karantina a été soufflé le 4 août 2020. Un an après, ses habitants, frappés de plein fouet par la crise économique dans laquelle s’enfonce chaque jour un peu plus le Liban, peinent à se relever du choc vécu ce jour-là.
Près d’un an après les explosions meurtrières survenues dans le port de Beyrouth qui ont ravagé leur quartier, les habitants de Karantina, déjà fragilisés avant le drame par la crise économique aiguë qui frappe le Liban, restent démunis et désemparés alors que le pays continue de s’enfoncer jour après jour dans l’inconnu.
Jusqu’au 4 août 2020, ce quartier défavorisé et marginalisé de Beyrouth, accolé au port de la capitale libanaise, pensait avoir tout vu et tout connu. Tirant son nom du mot français “quarantaine”, puisqu’à partir du milieu du XIXe siècle, les personnes et les marchandises arrivant par le port de lieux infectés y étaient mises à l’isolement, il est devenu au fil des ans l’abri de plusieurs vagues de réfugiés fuyant les troubles locaux ou régionaux. La dernière en date concernant des réfugiés syriens qui ont fui les combats dans leur pays à partir de 2011.

Longtemps réputé insalubre et pollué en raison de ses abattoirs, des vapeurs toxiques de sa décharge et de son incinérateur, Karantina est également connu dans l’histoire du Liban pour les sanglantes batailles qui s’y sont déroulées durant la guerre civile (1975-1990).
Aujourd’hui, quelques balafres encore visibles sur ses maisons traditionnelles, immeubles d’habitation, entrepôts et fabriques, rappellent cette période, mais ce sont surtout les destructions provoquées par la double explosion du 4 août qui ont défiguré le quartier.
Colère et tristesse
Grâce à l’action d’ONG locales et internationales et de bénévoles, sans lesquels les habitants n’auraient pas pu s’en sortir, les reconstructions et rénovations ont permis de réhabiliter plusieurs dizaines d’immeubles lourdement impactés. Mais le chantier est loin d’être terminé, comme viennent le rappeler les bruits des travaux entendus à intervalles régulières depuis les ruelles du secteur Medawar, où des ONG comme Offre Joie sont toujours à l’œuvre.

Un an après les explosions, Karantina tente aussi de soulager d’autres séquelles, psychologiques et mentales, bien moins visibles et plus compliquées à traiter.
En tournée sous une chaleur caniculaire dans le quartier, une équipe de Médecins du monde (MdM) parcoure les ruelles de Karantina, quelques semaines après la fermeture de son centre et le transfert des dossiers en cours de traitement à l’Hôpital universitaire Rafic Hariri.
“Un an après, les personnes qui étaient présentes le jour de l’explosion, qui ont été choquées ou blessées, sont devenues encore plus fragiles et affichent des états de stress post-traumatique, ou PTSD,” explique Rita Khoury, jeune travailleuse médico-sociale chez MdM, qui insiste sur les dommages subis par une population déjà très vulnérable et parfois traumatisée par plusieurs conflits violents. “Nous avons constaté qu’ils souffrent également de troubles du sommeil, de développement de phobies, d’anxiété, d’angoisses et de dépression”.
Au surlendemain de l’explosion, Médecins du monde a dépêché une équipe à Karantina afin de proposer un soutien psychologique aux victimes et aux habitants, notamment en mettant en place un centre d’accueil et en effectuant des visites à domicile. Près de 1 000 personnes ont ainsi été suivies. Au fil des semaines, l’ONG est parvenue grâce à ses psychothérapeutes à briser le tabou de la santé mentale auprès d’une population peu habituée à confier son désarroi.

“Alors que certains enfants très marqués font toujours des cauchemars et sursautent au moindre bruit qui fait ressurgir les souvenirs du 4 août, nous avons également vu un certain nombre d’adultes être habités par une grande tristesse ou de la colère parce qu’ils ne savent toujours pas ce qu’il s’est passé ce jour-là, alors qu’ils ont besoin de justice pour pouvoir se reconstruire”, précise Rita Khoury.
“Mes filles redoutent une nouvelle explosion”
Dans une rue à l’écart du secteur Khoder, le plus défavorisé de Karantina et dans lequel les équipes de MdM sont notamment intervenus les mois précédents, Aïcha Chahine ne veut plus cacher son courroux et cherche à exprimer sa peine.
“Un an après, rien n’a changé,” confie cette mère de famille âgée de 47 ans, depuis le pas de la porte de son domicile. “En fait, si : la situation a empiré, parce que depuis les explosions, je vois l’avenir en noir, et mes deux filles qui ont 11 et 9 ans ont de plus en plus peur, et ressentent en permanence du danger tout en redoutant une nouvelle explosion”.
Et d’ajouter, alors que l’émotion mêlée à la colère lui embue les yeux : “elles n’ont plus de motivation pour faire leurs devoirs alors qu’elles étaient les premières de leurs classes, et moi qui ai travaillé dur pour que l’une d’elles devienne un jour médecin et l’autre ingénieure, j’arrive à peine à leur rapporter de quoi leur donner à manger, je ne peux même pas leur offrir un carré de chocolat”.
En plus d’avoir vu sa maison située à 500 mètres du port soufflée par les explosions, la famille de Aïcha Chahine est frappée de plein fouet par la crise économique et l’effondrement de la monnaie nationale qui a perdu plus de 90 % de sa valeur face au dollar.

Alors que la situation ne cesse de s’aggraver dans le pays, et que les revenus de son foyer sont limités à 50 dollars par mois, elle craint de ne bientôt plus pouvoir payer le loyer de son logement et de finir à la rue avec ses enfants. “Plus rien ne va ici, les dirigeants nous ont abandonnées et renvoyées à l’âge de pierre,” dit-elle des trémolos dans la voix. “J’ai même peur que l’une de mes filles tombe malade et que je ne puisse pas lui payer son hospitalisation, alors que même les médicaments sont désormais inaccessibles ou en rupture”.
De plus en plus en colère à mesure qu’elle libère sa propre parole, elle hausse le ton contre la classe politique, accusée de corruption et rejetée en bloc par la population. “Ils ont fait de moi qui je suis, une femme instruite, une sans-abri qui court après les ONG pour rapporter de la nourriture à mes filles,” peste-t-elle. “Je fais tout pour garder espoir, mais à chaque fois, les politiciens prennent une décision qui vient tout détruire, donc s’il y a une révolution, j’irai participer, parce que nous voulons le changement et sans lui, rien ne changera dans ce pays”.
Aïcha Chahine qui a fait des études de droit et de psychologie est au chômage, à l’instar de son mari. “Je n’ai pas de travail parce que je n’ai pas de wasta [passe-droit, NDLR], ni de relation haut-placée dans le gouvernement,” développe-t-elle. “Je me suis dit : ce n’est pas grave, je peux rester à la maison pour aider mes filles à apprendre leurs leçons pour qu’elles préparent leur futur, mais je ne peux pas tolérer que l’avenir de ma fille, qui a échappé de justesse à la mort le 4 août, soit compromis par ces gens. Le gouvernement ne fait pas que nous priver de nos droits, il est en train de tous tuer. Donc s’il vous plaît, s’il vous plaît, sauvez-nous de toute cette corruption et du danger dans lequel nous vivons”.
“On ne tiendra plus longtemps dans ce pays”
À quelques mètres de là, sa belle-sœur Hanane Yassin, qui buvait ses paroles en acquiesçant d’un signe de la tête, se dit tout aussi inquiète pour l’avenir de ses trois enfants, dont son fils blessé le 4 août dans l’effondrement du toit de la maison, lourdement endommagée.
“Mes petits sont terrorisés par le moindre bruit venant du port, ils n’ont plus le moral et n’ont plus confiance dans ce pays,” témoigne-t-elle. “La vie est trop chère, il n’y a plus de médicament disponible pour ma fille asthmatique. On ne tiendra plus longtemps dans ce pays où il n’y a pas d’État”.
Selon elle, les explosions ont bouleversé les mentalités à Karantina. “Nos vies ont changé, tout le monde ne pense plus qu’à sauver sa peau, et j’ai l’impression que beaucoup d’habitants sont au bord de la crise de nerf à cause de la situation”, regrette-elle en ajustant son masque chirurgical d’une main et son voile noir à motif doré de l’autre.

Originaire du Sud Liban et installée depuis 11 ans dans le quartier avec sa famille, Hanane Yassin a dû retourner vivre chez ses parents pendant 6 mois, le temps que sa maison à loyer modéré puisse être reconstruite. Et ce, au frais de son foyer qui s’est endetté auprès de proches et d’amis, car elle affirme ne pas avoir bénéficié d’aide de l’une des nombreuses ONG déployées dans le quartier, en raison du coût très élevé des réparations nécessaires pour réhabiliter le logement.
“Nous avons tout perdu dans cette explosion alors que cette maison était très bien équipée, explique-t-elle en faisant le tour des pièces majoritairement vides pour illustrer ses propos. Nous ne pouvons pas nous permettre de remplacer les meubles et les équipements qui ont été détruits parce que tout est très cher”.
“Il n’y aura pas de solution sans révolution”
Une centaine de mètres plus bas, une ribambelle d’enfants miment des sports olympiques dans une rue plus proche du port et de la Méditerranée. Posté derrière les vitrines de sa petite boutique retapée par des ONG après les explosions du 4 août, Ghanem el-Issa, un fabricant de bougies septuagénaire, observe la scène avec une certaine mélancolie. Derrière lui, balayées par un ventilateur, des dizaines de bougies d’un blanc immaculé, dont certaines à l’effigie de la Vierge et du saint maronite Charbel, sont exposées sur des étagères en bois blanc.
Son ancienne usine, qu’il occupait depuis le milieu des années 1970 et située quelques rues plus loin dans le même quartier, a été détruite en quelques secondes, tandis que sur place, ses deux employées éthiopiennes ont failli y perdre la vie. Le matériel et les équipements toujours en état de fonctionner ont été volés par des pillards qui se sont infiltrés pendant la nuit dans les locaux à la faveur d’un pan de mur effondré.
“J’exerce ce métier depuis l’âge de 10 ans, et jamais je n’aurai imaginé vivre un jour pareil,” confie-t-il, en introduisant, pour montrer son savoir-faire, une mèche dans un petit gobelet rempli de cire chaude dans sa nouvelle fabrique, cachée derrière une petite porte qui la relie à sa boutique. “Pendant la guerre du Liban, il pouvait pleuvoir des obus de temps en temps, mais nous n’avions pas connu une telle situation parce qu’on pouvait reprendre le travail dès le lendemain. Mais après le 4 août, c’était inimaginable parce qu’ils ont fait sauter une bombe nucléaire”.
Son activité étant à l’arrêt, en raison de l’annulation depuis plus d’un an des grandes cérémonies religieuses pour cause d’épidémie de Covid-19, Ghanem el-Issa, père de six enfants et plusieurs fois grand-père, n’arrive plus à vivre convenablement de son métier.

“J’ai réuni suffisamment d’argent pour pouvoir payer le rapatriement de mes deux employées qui étaient en état de choc et se demandaient dans quel pays de fou elles avaient atterri, et réduit mon activité. Parce que le matériel est devenu trop cher, parce qu’il n’y a plus de fête religieuse à cause du coronavirus et parce que les gens n’ont plus d’argent à cause de la crise économico-financière,” explique-t-il, peinant à masquer un profonde chagrin. “Nous vivons un enfer ici, mais que peut-on y faire ? Mendier auprès de ses propres enfants ou de ses voisins qui sont eux-mêmes frappés par la crise ? “.
Au moment de retourner dans sa boutique près du ventilateur salvateur, Ghanem el-Issa jette un clin d’œil complice à son jeune apprenti pour qu’il prenne la relève et termine de placer les mèches.
“Il n’y aura pas de solution sans révolution. Quitter le pays est tentant mais à qui va-t-on le laisser ? Si Dieu le veut, le 4 août, comme beaucoup de mes compatriotes, nous irons manifester pour demander justice et faire entendre nos voix parce que nous pouvons plus supporter de vivre dans ces conditions”.