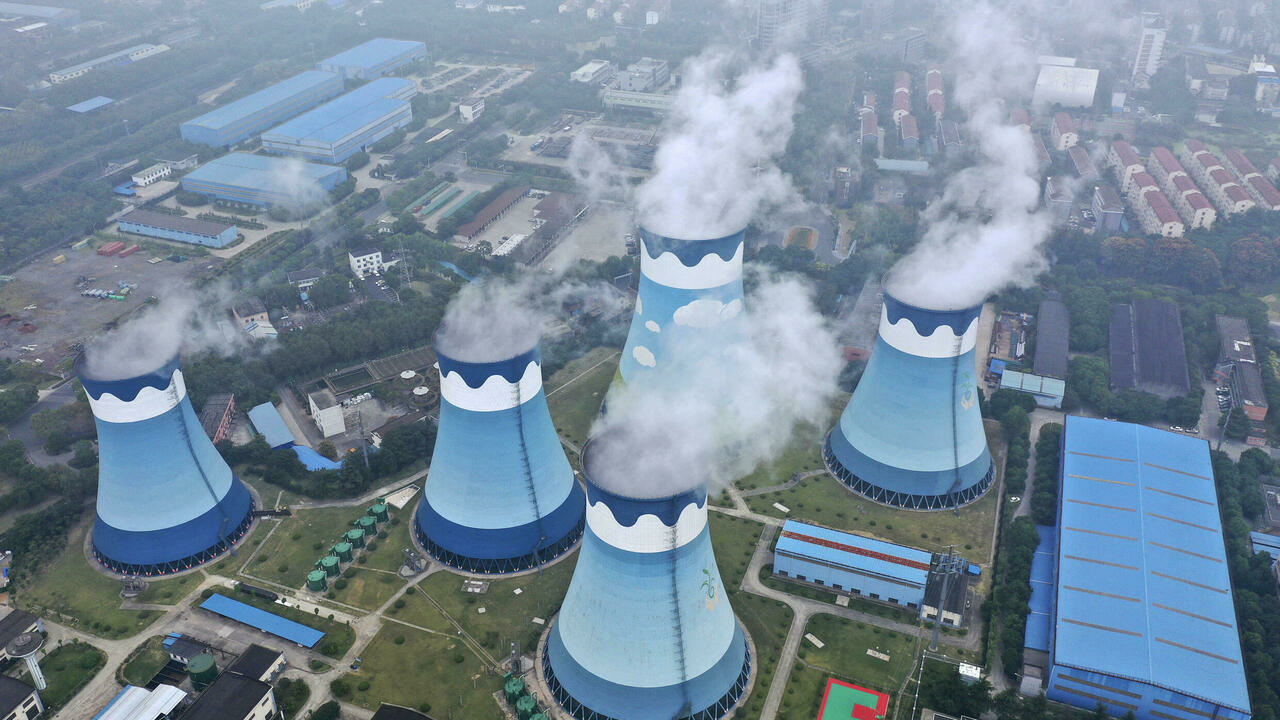Le désir de Donald Trump d’éviter les relations avec l’étranger n’est pas nouveau. En 1987, il a payé des publicités dans le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe dans lesquelles il affirmait que les États-Unis étaient exploités par d’autres pays qui développaient leurs économies “sans être gênés par les coûts énormes de leur défense parce que les États-Unis le faisaient gratuitement” – écrit Dick Roche, ancien ministre irlandais des affaires européennes et ancien ministre de l’environnement.
Dick Roche, ancien ministre irlandais des affaires européennes
La position de Trump à l’époque et aujourd’hui n’est pas en contradiction avec l’histoire des États-Unis.
George Washington a insisté pour que les États-Unis se tiennent à l’écart des guerres étrangères. Il estimait que les États-Unis devaient essayer de maintenir une politique de neutralité dans leurs relations avec les gouvernements étrangers. Thomas Jefferson était favorable à une politique d’implication dans les conflits européens.
Les États-Unis ont participé à contrecœur et tardivement à la première guerre mondiale. Le président Wilson n’a décidé de s’impliquer qu’à la suite des attaques de sous-marins allemands contre des navires de passagers et de commerce.
Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis se sont lassés de participer à des guerres étrangères.
Les tendances non interventionnistes reprennent le dessus dans la politique américaine. Les États-Unis étaient un partenaire réticent de la Société des Nations. Dans les années 1930, des critiques ont affirmé que l’engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale avait été motivé par des banquiers et des négociants en munitions ayant des intérêts commerciaux en Europe.
En 1935, le Congrès adopte la première loi sur la neutralité, qui interdit l’exportation “d’armes, de munitions et d’instruments de guerre”. En 1937, la loi sur la neutralité a été élargie. En 1939, les efforts du président Roosevelt pour fournir des armes à la Tchécoslovaquie se heurtent au Congrès.
Les États-Unis se sont tenus à l’écart de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au bombardement de Pearl Harbour par les Japonais en décembre 1941. Lorsque les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon, l’Allemagne et l’Italie ont déclaré la guerre aux États-Unis.
Les choses ont changé après la Seconde Guerre mondiale
Après la Seconde Guerre mondiale, les inquiétudes suscitées par la propagation du communisme ont entraîné un changement. En 1947, le gouvernement britannique a annoncé qu’il ne pouvait plus se permettre de soutenir le gouvernement grec qui faisait face à une insurrection communiste armée.
Il s’agit de la dernière d’une série de “retraits” de la part des Britanniques. En proie à de graves difficultés financières après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique avait réduit ses engagements en matière de maintien de la paix en Palestine, diminué son engagement en Inde et retiré sa présence militaire d’Égypte.
Craignant qu’un vide résultant du retrait britannique ne laisse la porte ouverte à Moscou pour étendre rapidement l’influence communiste, le président américain a décidé qu’il était nécessaire d’agir. [Un retrait britannique de Grèce, d’Égypte et de Palestine créerait, craignent les Américains, des vulnérabilités militaires en Méditerranée orientale et pourrait signifier que le canal de Suez tomberait sous le contrôle de l’Union soviétique].
Le président Truman annonce que “les États-Unis doivent avoir pour politique de soutenir les peuples libres qui résistent aux tentatives d’assujettissement par des minorités armées ou par des pressions extérieures”. Cette déclaration est à l’origine de la doctrine Truman, du plan Marshall et, en fin de compte, de la création de l’OTAN – et du fait que les États-Unis assument la “responsabilité de la direction du monde libre”.
Depuis la guerre du Viêt Nam, le pendule est lentement revenu vers le non-interventionnisme aux États-Unis.
Donald Trump a clairement perçu qu’il s’agissait d’un mouvement politique potentiellement important dès 1987, lorsqu’il a acheté ses publicités dans le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe.
Au cours de son premier mandat, M. Trump n’avait ni l’expérience ni la capacité d’aller dans la direction qu’il préconisait dans ces publicités. Il est dans une position beaucoup plus forte pour agir au cours de son second mandat. Cela pose un problème très réel à l’Europe. Il soulève également deux questions pour les responsables politiques de l’UE
Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour voir venir les choses ?
Dick Roche est un ancien ministre irlandais des affaires européennes et un ancien ministre de l’environnement.