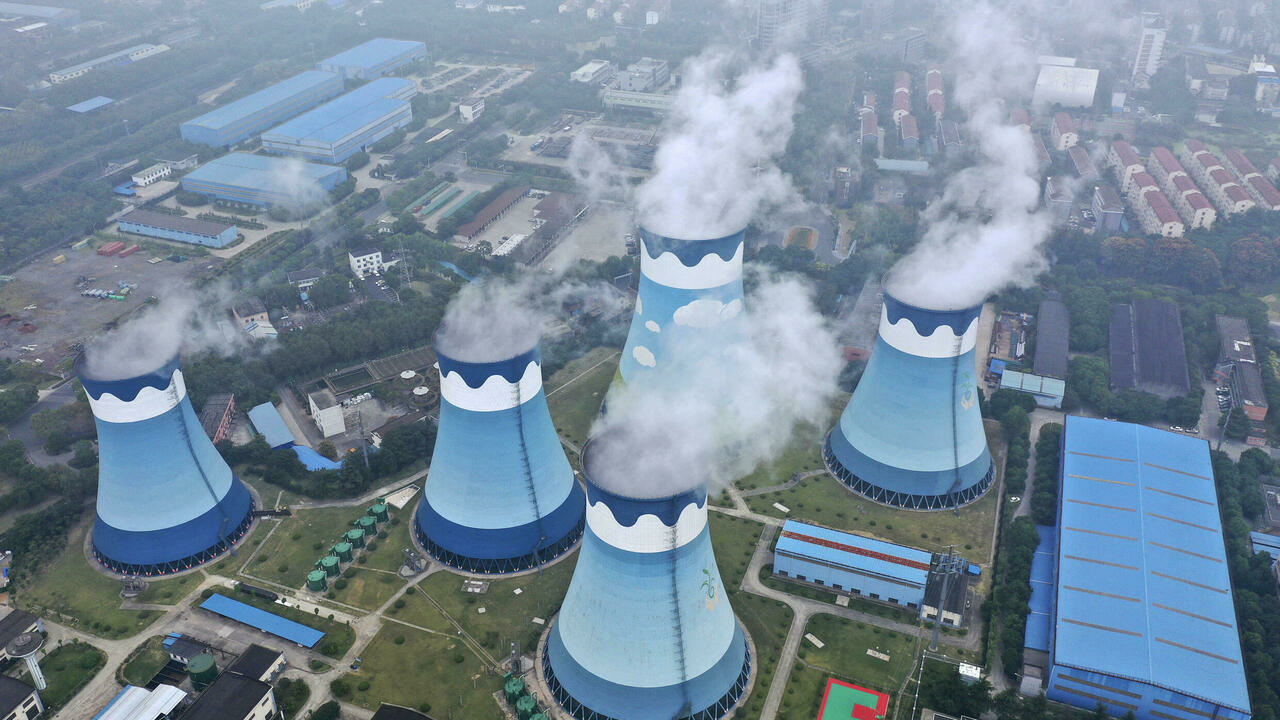Publié le : 05/10/2022
À Camini, un petit village isolé de Calabre, dans le sud de l’Italie, une centaine de migrants arrivés ces dernières années vivent et travaillent grâce à une coopérative créée par les habitants. Leur présence a permis au bourg de retrouver un semblant d’activité. Reportage.
Charlotte Oberti, envoyée spéciale à Camini (Italie).
Il faut essayer d’imaginer la place du village il y a quarante ans. Elle était, selon les dires, animée et bruyante. Les habitants aimaient discuter, accoudés à l’un des trois bars que comptait alors Camini, bourg de Calabre qui surplombe une vallée d’oliviers plongeant dans la mer. Mais désormais le cœur de Camini est triste. En cette fin septembre, la terrasse dressée sur l’esplanade proche de la mairie est quasiment vide, comme les rues. En contrebas, une meute de chiens errants aboient et courent au milieu d’une route sans déranger les voitures qui de toute façon n’y roulent pas.
Dans les années 1990, les habitants ont déserté Camini, où vivent 800 personnes, réparties entre deux zones : la basse, près de la mer, et la haute, perchée sur la colline. La faute au manque d’emploi dans cette région pauvre du sud de l’Italie, où le tourisme peine à se développer malgré la beauté des lieux.

Camini n’était en rien une exception au moment de l’exode de sa population, mais elle semble en être une aujourd’hui. Car sur ses hauteurs, la vie a repris timidement ces dernières années. Un bar restaurant – l’unique désormais – a ouvert; l’école primaire, qui pendant 20 ans ne comptait plus qu’une classe, en compte désormais quatre; et un distributeur automatique de billets y a pris ses quartiers en 2020 pour le bonheur du plus grand nombre.
“Tout ce qui est là est lié aux migrants”, lance Rosario Zurzolo, enfant du pays. Cet homme de 45 ans à l’air pressé a dû quitter son village natal à la vingtaine, la mort dans l’âme, pour trouver du travail ailleurs. De retour quelques années plus tard, il a cofondé en 1999 la coopérative EuroCoop Camini dans le but de contenir l’hémorragie des habitants en créant des emplois. Mais les choses n’ont vraiment changé qu’à partir de 2016, quand la municipalité a remporté un appel à projets du ministère de l’Intérieur concernant l’accueil de migrants. Selon ce projet, EuroCoop Camini touche 35 euros par jour et par migrant pour couvrir leurs besoins du quotidien et leur logement.
>> À (re)lire : La Calabre, terre de l’autre côté de la Méditerranée où les migrants sont “bien traités”
Aujourd’hui environ 150 migrants, venus d’Afghanistan, du Maroc, de Tunisie, de Libye, du Soudan du Sud, du Pakistan, du Bangladesh, du Nigeria, de Syrie, vivent à Camini, ce qui en fait l’une des communes de la péninsule au plus fort taux d’immigrés parmi sa population. Leur présence, à elle seule, a suscité un élan de solidarité d’organismes qui ont injecté de l’argent dans les caisses du village. La coopérative embauche 18 personnes et a ouvert plusieurs ateliers d’artisanat dans lesquels travaillent des réfugiés : céramique, travail du bois, création de vêtements et d’art.
Dans les rues du village, des femmes voilées et leurs enfants se baladent, passant devant les vieux Italiens qui campent sur le perron de leur maison. Rosario Zurzolo ne rate rien des allers et venues. Le regard partout, il gratifie chacun d’un “Ciao!” ou d’une tape dans le dos. “On a créé une sorte d’économie circulaire”, explique-t-il fièrement. “Les gens que vous croisez ici sont pour la plupart mes employés.”
“La première arabe”
Amal Ahmad Okla se décrit comme “la première arabe” de Camini. Arrivée en 2016, cette Syrienne de 43 ans et mère de cinq enfants a fui Damas en 2013 pour le Liban. Après trois ans de misère, sans travail, elle a pu bénéficier du programme de relocalisation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et démarrer une nouvelle vie en Italie, à Camini. En Syrie, son frère et sa mère ont été tués en même temps dans un bombardement.

“C’était difficile au début, surtout à cause de la barrière de la langue”, explique-t-elle, en arabe. Elle a depuis appris les rudiments de l’italien et à manier le métier à tisser. Dans un local du village niché dans une rue étroite, elle confectionne, en djellaba et à pieds nus, de petits tapis et des sacs, qui sont mis en vente dans une boutique attenante. Les acheteurs par ici sont rares mais, quoi qu’il en soit, Amal Ahmad Okla touche environ 500 euros par mois ce travail. Elle est payée par EuroCoop Camini qui bénéficie, outre l’aide de l’Etat, de dons de différentes organisations.
“L’idée, c’est de donner une activité à ces gens, commente Rosario Zurzolo. C’est de la thérapie par l’art.”
Amal Ahmad Okla a l’air absente en maniant le métier à tisser. Six ans après son arrivée, elle dit se sentir toujours perdue dans ce petit village isolé. “Les gens sont gentils et accueillants. Je trouve que leur mentalité est similaire à celle des arabes car ils sont très proches de leur famille, les plus âgés vivent avec leurs enfants et petits-enfants”, observe-t-elle. “Je ne suis pas inquiète quand ma fille sort le soir dans le village, je suis en sécurité ici. Mais la Syrie me manque.” Surtout, cette femme se pose des questions sur son avenir, dans une commune qui n’a rien à offrir à ses enfants âgés de 9 à 21 ans. “Ils vont devoir partir pour faire leurs études. Mon destin dépendra de l’endroit où ils iront. À Camini, il râlent tout le temps. Ils s’ennuient. Ils se plaignent par exemple qu’on n’aille pas plus souvent à la mer, pourtant proche, mais c’est un gros voyage en bus pour nous.”
Non loin de là, la famille d’Haseed Bukari, originaire du Pakistan, tient une boutique depuis 2019. Les parents de ce jeune homme de 17 ans confectionnent des accessoires (sacs, taies d’oreillers, serre-têtes…) dans une petite pièce remplie de moustiques.

“Cela fait sept ans qu’on est là mais on ne se sent toujours pas stables”, explique Haseed Bukari, traduisant les paroles de ses parents à ses côtés. La famille avait une première fois tenté de se reconstruire en Libye, avant la chute de Mouammar Kadhafi. Puis, en 2014, ils se sont résignés à partir, à bord d’un bateau sur la Méditerranée. “Mes parents adorent Camini, poursuit Haseed Bukari, mais le problème, c’est les transports. Ils ont besoin de se rendre régulièrement à la préfecture pour renouveler leur titre de séjour, et je dois y aller avec eux pour traduire. Mais c’est si loin que ça me fait rater à chaque fois une journée d’école.” L’adolescent fêtera ses 18 ans en décembre : “La première chose que je vais faire, c’est trouver une voiture.”
“Peut-être qu’un jour, le maire s’appellera Mohamed”
Attablé à la place du village, Pino Alfarano, le maire, cheveux blancs gominés et gourmette au poignet, dresse un bilan différent. “La coopérative donne aux personnes de l’espoir et aux jeunes, une nouvelle vie”, assure-t-il. Pour sa commune, le constat est positif même si la vie est différente d’antan.
“Sur cette place, avant, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient la même langue. Maintenant il y a des gens, parfois, mais qui ne parlent pas la même langue”, sourit-il, expliquant qu’il ne comprend pas l’arabe mais parvient à communiquer avec “le langage corporel”.
“Nous ne serions pas là sans les migrants. Tout le monde serait parti de Camini”, renchérit Rosario Zurzolo. Ce dernier assume avoir été influencé par Riace, un village voisin devenu un modèle en termes d’intégration des migrants, après que le maire a ouvert les portes de maisons laissées à l’abandon pour les loger.
Quant aux critiques, les deux hommes forts du village les balaient d’un revers de la main. “Certains disent qu’on en fait plus pour les migrants que pour les Italiens. Mais beaucoup d’Italiens ne veulent tout simplement pas s’impliquer dans la communauté”, commente Pino Alfarano, calmement. “Je ne suis en tout cas pas inquiet à l’idée que notre culture se perde. Il y a toujours beaucoup plus d’Italiens que de migrants ici et les jeunes qui arrivent apprennent notre culture par le biais de l’école. Qui sait, peut-être qu’un jour l’un d’eux sera le nouveau maire. Un maire qui s’appellera Mohamed. Et alors ? Cela n’a aucune importance.”