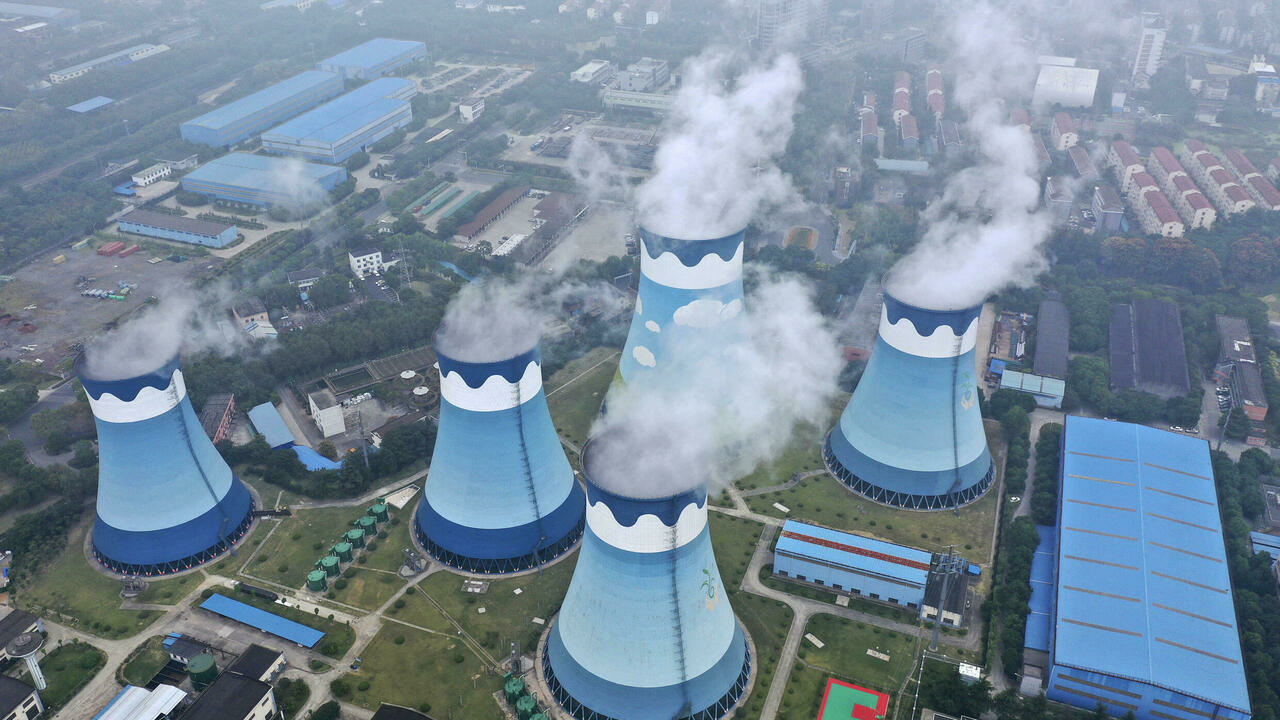Les journalistes de France 24 Amar Al Hameedawi et Jonathan Walsh ont reçu, samedi 4 juin, la “Mention spéciale du jury” pour leur reportage “Irak, la révolution assassinée” lors de la 29e édition du FIGRA 2022 (Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société) qui s’est tenue à Douai.
À l’automne 2019, un mouvement de contestation sans précédent embrase Bagdad et le sud de l’Irak majoritairement chiite. Dans le viseur des manifestants, la corruption généralisée et l’incurie de la classe politique, mais aussi la tutelle de l’Iran voisin et l’emprise de ses milices sur le pays. La répression, d’une extrême violence, fait au moins 600 morts et 21 000 blessés en quelques mois. Parallèlement, des assassinats visent les dirigeants du mouvement, une série toujours en cours. Et alors que le pays s’apprête à élire ses députés, de plus en plus de voix accusent les factions armées pro-iraniennes d’être derrière cette campagne de violence systématique. Reportage de Jonathan Walsh et Amar Al Hameedawi.
“Ils ont tué une voix libre, un nationaliste”, s’emporte Ali Al-Wazni, venu se recueillir sur la tombe de son frère Ihab, quarante jours après sa mort. Ihab Al-Wazni a été assassiné le 9 mai 2021 devant chez lui, au volant de sa voiture. Il était l’une des figures les plus respectées de la contestation à Kerbala, ville sainte chiite située à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. “Il voulait seulement une vie digne pour son peuple, améliorer la vie des gens. Et aussi dévoiler la vérité au sujet de ces partis et de ces milices. Ces milices qui tuent le peuple irakien depuis des années et veulent voler ses richesses”. Ces accusations sans détour sont devenues monnaie courante, dans ce pays où les factions armées sont plus puissantes que jamais. La justice irakienne n’a procédé à aucune condamnation dans cette affaire, et la mère d’Ihab enrage : “Si la justice ne peut pas faire son devoir, alors elle ne sert à rien”.
Des dizaines d’activistes ont été froidement assassinés depuis deux ans. Ils étaient les leaders de la “révolution d’octobre”, un soulèvement populaire d’une ampleur inédite qui a embrasé Bagdad et toutes les grandes villes du sud de l’Irak à partir de l’automne 2019. Le chômage galopant, la corruption généralisée et la déliquescence des services publics sont devenus insoutenables pour une grande partie de la population. D’immenses manifestations sont organisées pour exiger des réformes majeures et un changement de gouvernement. Les contestataires dénoncent aussi la tutelle des partis confessionnels et de leurs factions armées. Beaucoup paieront de leur vie cet engagement.
“Une milice m’a envoyé un émissaire, qui m’a dit que si je rentrais chez moi, on me tuerait”, explique Hussein Al-Ghorabi. “C’est difficile de dire leurs noms, car si je le fais, je pense que je mourrai”. Cet activiste a fui Nassiriya, une ville du sud qui fut longtemps l’épicentre de la contestation. Visage incontournable du mouvement, il mène aujourd’hui une vie d’homme traqué. Hussein Al-Ghorabi se rêve pourtant un destin politique qui lui permettrait de défendre les idées de la “révolution d’octobre”. “J’ai un devoir moral après le sacrifice de ceux qui sont morts pendant la révolution, je dois porter leur voix”, clame-t-il. “La souffrance qui frappe les villes du sud majoritairement chiites est la même qu’au temps de Saddam Hussein. Il n’y a pas de justice sociale, pas d’infrastructures, pas de travail. Tout cela a poussé la rue à se soulever, c’est ça la ‘révolution d’octobre’.”
Une menace pour le pouvoir régional de l’Iran
C’est dans ce sud déshérité que les milices ont recruté en masse pour combattre le groupe État islamique. L’ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite en Irak, appelle à prendre les armes contre les jihadistes en 2014. Ces groupes connaissent alors une montée en puissance sans précédent, avec l’aide de l’Iran voisin. Comme tous les contestataires, Hussein Al-Ghorabi accuse aujourd’hui ces mêmes factions armées de vouloir assassiner la “révolution d’octobre” : “Nous sommes des villes qu’ils prétendent défendre, mais malheureusement ils ont retourné leurs armes et leurs silencieux contre nous. Ils pensent que l’État irakien que l’on rêve représente leur disparition, la fin des milices”.
Les assassinats ciblés s’inscrivent dans une campagne de violence systématique qui remonte aux premiers jours du mouvement de contestation. “Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, il y a eu 600 morts, ce n’est pas rien ! 600 morts, 21 000 blessés, 29 000 incarcérés ! Le degré de la répression était terrible”, rappelle avec véhémence Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l’Irak. Les forces de sécurité acceptent aujourd’hui une part de responsabilité. Mais des groupes armés sont eux aussi accusés d’avoir ciblé les manifestants lors d’actions illégales meurtrières. Même l’ancien Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, l’admet : “Des forces plus puissantes que l’État ne voulaient pas entendre ces voix et ont réprimé les manifestations”.
Un personnage clé est régulièrement désigné comme le cerveau de la répression durant les premiers mois de la contestation : le général iranien Qassem Soleimani, commandant des forces d’élite des Gardiens de la révolution. Avant son élimination, en janvier 2020, par un tir de drone américain, il se rend régulièrement en Irak. “Qassem Soleimani lui-même avait mis en place un comité”, affirme Adel Bakawan. “Bien entendu, il ne l’a pas appelé comité de répression. C’était un comité de stabilité et de sécurité, quelque chose de cette nature, et Soleimani en personne élaborait le programme quotidien de la répression”.
“Ces jeunes, ces manifestations, sont une attaque à leur influence. C’est une menace pour le pouvoir régional que l’Iran souhaite jouer. Et donc, il faut qu’ils soient rendus silencieux”, renchérit Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty international. Face aux violences qui se multiplient, les manifestants accusent ouvertement leur puissant voisin et les milices proches de Téhéran. Des représentations diplomatiques iraniennes sont prises pour cibles dans plusieurs villes du sud.
La toute-puissance des groupes paramilitaires
La mort de Qassem Soleimani ne met pas fin à la répression. Les groupes armés serrent les rangs et même le puissant Moqtada Al-Sadr, nationaliste revendiqué, appelle rapidement à la fin du mouvement de contestation. Pourtant, ses hommes sont d’abord chargés de protéger les rassemblements. Mais les affrontements se multiplient et, en février 2020, les sadristes sont accusés d’avoir tué plusieurs manifestants dans la ville sainte de Nadjaf.
En dénonçant l’emprise des factions armées, la “révolution d’octobre” s’est heurtée aux fondements mêmes du nouvel État irakien. Après 2003, le système confessionnel a donné une place prépondérante aux chiites, persécutés sous Saddam Hussein. Les dirigeants de cette communauté ont depuis fait de leurs groupes paramilitaires des acteurs tout-puissants, souvent avec l’aide de l’Iran.
Deux ans après son déclenchement, le soulèvement populaire s’est essoufflé. La peur gagne toujours du terrain, et les assassinats continuent. Le fils de Fatima Al-Bahadili, une activiste connue de Bassora, a été abattu fin juillet. Une fois de plus après des menaces répétées de miliciens.