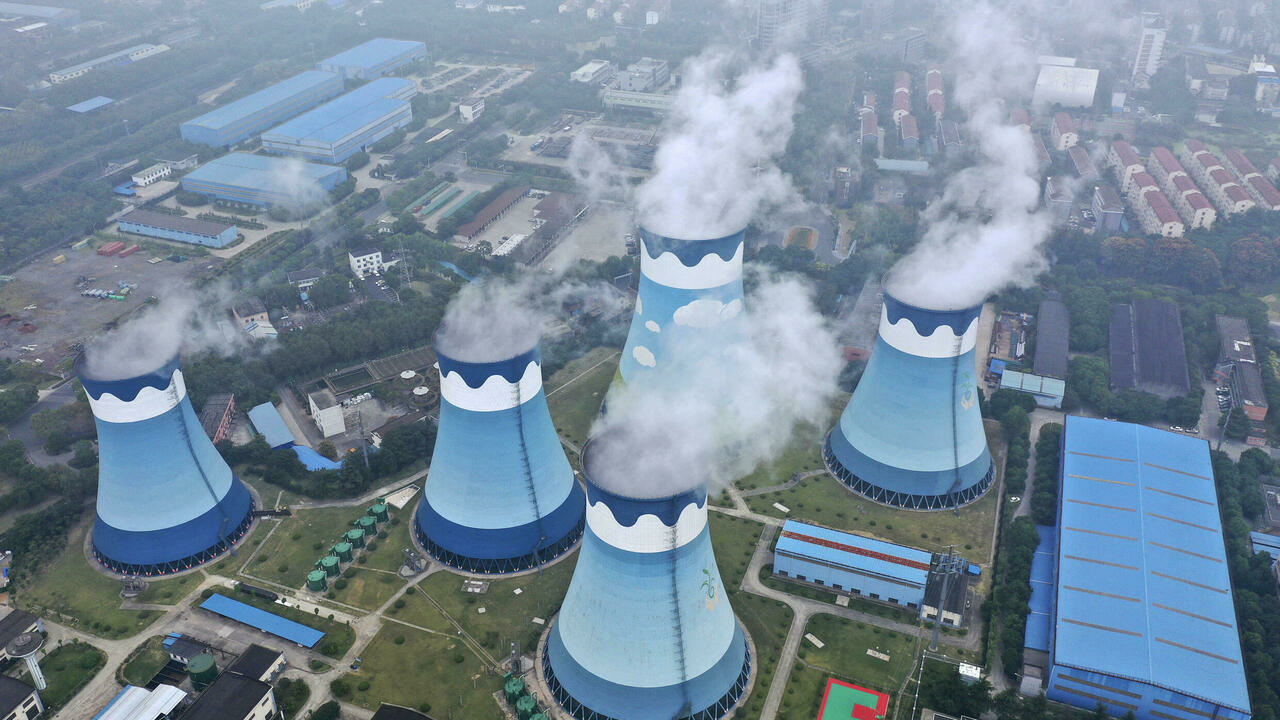Lors de la conférence des Nations unies sur l’Afghanistan organisée lundi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a affirmé que l’aide humanitaire devait servir de levier pour inciter les Taliban à respecter les droits de l’Homme. Une posture jugée dangereuse et contreproductive par l’ONG Action contre la faim.
Les Nations unies ont lancé, lundi 13 septembre, une campagne de dons visant à récolter une aide financière d’urgence de 600 millions de dollars pour les organisations humanitaires présentes en Afghanistan. Une assistance cruciale dans ce pays ravagé par des années de guerre, contrôlé depuis mi-août par les Taliban, et que le patron de l’ONU souhaite utiliser comme levier pour faire respecter les droits de l’Homme.
“Si nous voulons faire progresser les droits de l’Homme pour le peuple afghan, le meilleur moyen est d’aller de l’avant avec l’aide humanitaire, de dialoguer avec les Taliban et de tirer avantage de cette aide pour pousser à la mise en œuvre de ces droits”, a expliqué Antonio Guterres, en marge de la réunion ministérielle à Genève.
Une sortie critiquée par Pierre Micheletti, le président de l’organisation Action contre la Faim, présente en Afghanistan depuis 40 ans, qui dénonce une volonté d’instrumentaliser le travail humanitaire et réfute tout rôle de monnaie d’échange. Entretien
France 24 : La campagne de dons des Nations unies affiche un but double, venir en aide aux Afghans et s’assurer que les Taliban respectent certaines libertés fondamentales, notamment les droits des femmes. Ces deux approches ne vont-elles pas de pair ?
Pierre Micheletti : Il faut bien distinguer deux aspects : que les Nations unies appellent les Taliban à respecter les droits des femmes et envoient un signal contre toute forme de discrimination ne nous pose évidemment pas de problème. La question d’utiliser l’aide humanitaire pour pousser au respect des droits de l’Homme est plus problématique car toute prise de parole qui présente le travail des ONG comme bras politique menace notre action.
Notre mission relève du droit international humanitaire, c’est un corpus juridique qui fixe un minimum de règles sur le droit de la guerre et établit les principes fondamentaux des organisations humanitaires que sont l’impartialité, la neutralité et l’indépendance. Ce socle permet aux ONG d’accomplir leur seule et unique mission qui est d’apporter une aide minimale aux personnes en détresse. Ces principes sont d’autant plus importants aujourd’hui, dans un contexte où 90 % des victimes de conflits sont des civils. Si nous sortons de notre champ de compétence en dénonçant des injustices et en prenant position pour un groupe ou un autre, nous dérogeons au principe de neutralité. Nous risquons alors d’être perçus comme un acteur du conflit et de devenir une cible légitime aux yeux du pouvoir en place ou de l’opposition armée en cas de guerre civile. Or nous ne sommes ni un acteur du conflit ni une monnaie d’échange.
Quels risques cette instrumentalisation de l’aide humanitaire fait-elle courir à une ONG comme la vôtre sur le terrain ?
Lorsque Antonio Guterres nous fait porter un rôle politique, il nous expose à deux types de risques. Nous pouvons tout simplement être bannis du pays, ce qui prive de facto des centaines de milliers d’Afghans de l’aide à la survie dont ils ont dramatiquement besoin. Ce type de propos peut également nuire à l’efficacité de notre travail sur le terrain en générant des problèmes sécuritaires, notamment pour le personnel afghan qui représente l’essentiel de nos équipes et est déjà trop souvent considéré comme une cible privilégiée. Sur place, nous avons 350 locaux et 12 expatriés. Selon les études régulières publiées par l’organisation Humanitarian Outcomes, le risque d’accident de sécurité causant la mort est quatre fois plus important chez les travailleurs nationaux que parmi le personnel étranger, tous terrains de crise confondus. Dans ce contexte, le soupçon d’ingérence politique peut avoir des conséquences désastreuses pour nous en tant qu’ONG, qui ne pouvons plus travailler, pour les populations en détresse, qui n’ont plus accès à l’aide, mais aussi pour nos employés locaux. De plus, si notre ONG est forcée de quitter le pays, qu’adviendra-t-il de notre personnel resté sur place ?
Les Nations unies doivent composer avec un pouvoir qui figure sur sa liste de groupes terroristes. N’est-il pas légitime d’exiger des garanties ? Qu’en est-il du risque de détournement de cette aide ?
Il y a beaucoup d’hypocrisie sur ce sujet de la part des institutions qui ont négocié à Doha avec les Taliban, en écartant le gouvernement légitime du pays, et qui semblent maintenant découvrir qui ils ont comme interlocuteur ! Les ONG conduisent des évaluations de leurs programmes et rendent des comptes à leurs financeurs. Ce système visant à contrôler l’utilisation des fonds existe déjà au sein des organisations, y compris des agences des Nations unies. Nous devons bien sûr être comptables de nos actions, mais pas instrumentalisées : l’aide humanitaire ne doit pas servir l’agenda politique des États. Encore une fois, la boussole doit être le secours aux populations dans le besoin.
Par ailleurs, les ONG ont des règles bien définies qui encadrent leur action pour assurer un accès égalitaire à l’aide. À titre d’exemple, Action contre la faim ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Si nous nous retrouvons dans une situation où c’est le cas, il faudra alors décider de rester ou pas. Nous recherchons un équilibre permanent entre le coût et l’efficacité de nos actions et nous devons conserver notre libre arbitre. Nous travaillons de concert avec les acteurs internationaux, mais il faut que chacun fasse son travail et respecte son cadre juridique. On parle d’un pays où dix millions de personnes souffrent actuellement de sous-nutrition, avec des phénomènes de sécheresses, d’inondations et qui a en plus été très affecté par la crise du Covid-19 ; le degré d’urgence est maximal.
L’annonce du départ des troupes occidentales a précipité la situation en Afghanistan. La France a récemment annoncé son intention de mettre fin à son opération militaire contre les terroristes au Sahel, où vous êtes également présent. Votre action humanitaire est-elle menacée dans cette zone ?
Au cours des dernières années, la situation s’est nettement détériorée au Sahel pour les travailleurs humanitaires. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso notamment sont aujourd’hui des territoires à hauts risques. Nos équipes ont été dramatiquement concernées par cette violence dans le Borno, au Nigeria.
Là aussi, nous sommes confrontés au phénomène de rétraction des espaces humanitaires, qui signifie que les conditions ne nous permettent plus de travailler de manière satisfaisante, privant alors les populations de l’accès à une aide parfois vitale pour leur survie. Chez Action contre la faim, nous faisons tout pour faire prévaloir nos principes mais notre positionnement est de plus en plus remis en cause par une partie des belligérants. Cela peut être dû à des considérations politiques comme expliqué plus haut, mais aussi à des facteurs culturels avec des groupes comme Boko Haram, qui considèrent que les travailleurs humanitaires étrangers sont par essence des mécréants, par ailleurs suspects d’être complices des autorités du pays. Je ne sais pas ce qu’il adviendra avec le retrait des troupes françaises du Sahel, mais il est certain que nos principes en tant qu’ONG sont de plus en plus difficiles à défendre dans des contextes aussi complexes.
Pierre Micheletti est l’auteur de “0,03 % Pour une transformation du mouvement humanitaire international” (Parole éditions)