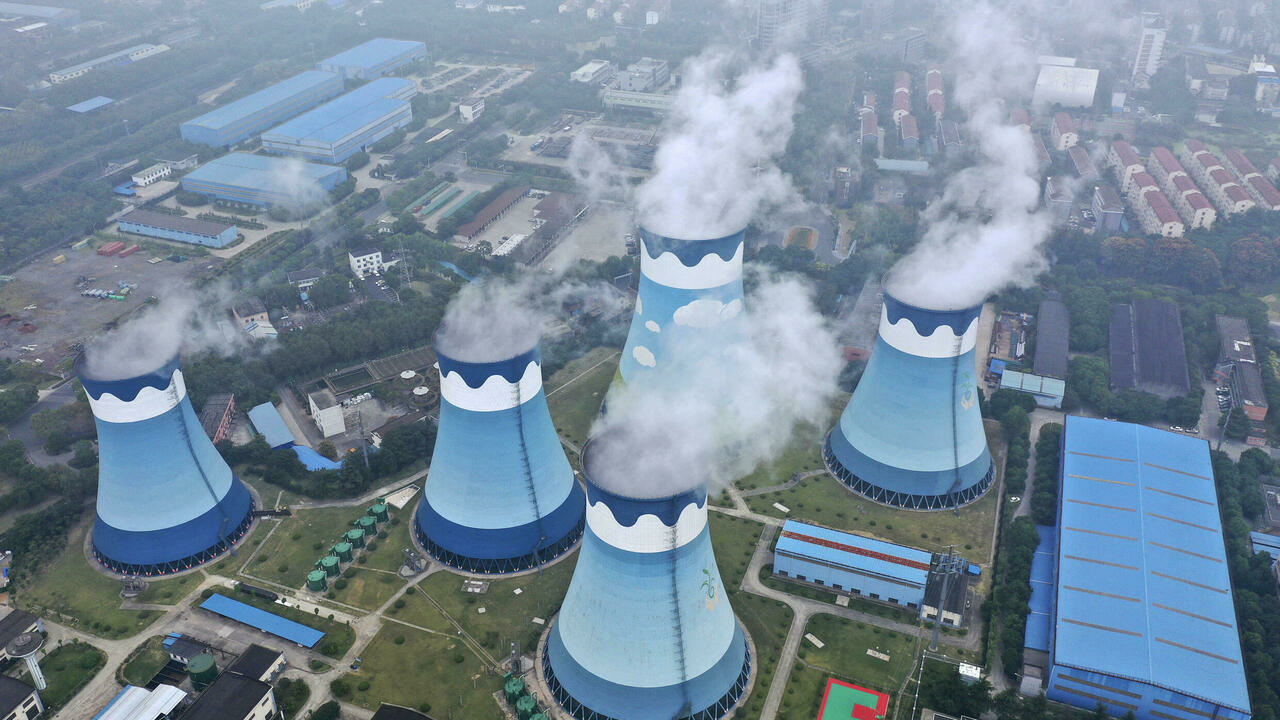Le 8 septembre 1941 commençait le siège de Leningrad, l’un des objectifs majeurs de l’offensive allemande lancée quelques mois auparavant lors de l’opération Barbarossa. Pendant 872 jours, ses habitants vont vivre l’enfer, subissant la faim, le froid et les bombardements. Près d’un million de civils trouvent la mort.
“Jenia est morte le 28 décembre à minuit. Grand-mère est morte le 25 janvier à trois heures de l’après-midi. Leka est morte le 5 mars à cinq heures du matin. Oncle Liocha est mort le 10 mai à quatre heures de l’après-midi. Maman est morte le 15 mai à sept heures trente du matin. Les Savitchev sont morts. Tout le monde est mort. Tania est toute seule.” Tania Savitcheva a onze ans lorsque commence le siège de Leningrad, le 8 septembre 1941. En quelques mois, la jeune fille assiste impuissante à la disparition d’une grande partie de sa famille. Évacuée avant la fin du siège, elle meurt d’épuisement le 1er juillet 1944. Elle devient alors le symbole des victimes de ce siège de plus de deux ans (872 jours), le plus long de l’histoire moderne jusqu’à celui de Sarajevo dans les années 1990.

Quand Adolf Hitler déclenche l’invasion de l’Union soviétique le 22 juin 1941, Leningrad – aujourd’hui renommée Saint-Pétersbourg – est l’un des objectifs majeurs de l’armée allemande. “Cette ville est d’abord un symbole. C’est l’ancienne capitale du tsar et de la Révolution (d’octobre 1917)”, résume l’historien Pierre Vallaud, auteur de “L’Étau. Le siège de Leningrad” (éd. Fayard). “C’est aussi un verrou par rapport à la Baltique. C’est un point stratégique très important dans le cadre de la conquête de l’URSS et de l’espace vital voulu par Hitler.”
Dans les premières semaines, les troupes de la Wehrmacht, secondées par l’armée finlandaise alliée du IIIe Reich, avancent rapidement. En deux mois et demi, elles arrivent aux portes de Leningrad. “Pendant ce laps de temps, la ville a eu le temps de se barricader et de préparer la résistance. Hitler va donc donner l’ordre de la détruire soit par la mer, soit par la terre, sans y rentrer. Il a bien conscience que c’est quasiment impossible de prendre une ville aussi grande car cela signifie engager des combats de rue”, décrit Pierre Vallaud. Le mot d’ordre est simple. Leningrad doit être “rasée de la surface de la Terre”.

La famine s’empare de Leningrad
La ville est encerclée par les Allemands au sud et les Finlandais au nord. Les bombardements sont intenses. Le blocus commence. Les habitants se retrouvent coupés de toute source de ravitaillement, à l’exception d’un petit corridor sur le lac Ladoga – surnommé la “Route de la vie”, mais qui n’était pas toujours en état de fonctionner. Les réserves de nourriture ne permettent de tenir qu’un mois. C’est le début d’un long cauchemar.
Sarah Gruszka, docteure en histoire, a étudié des centaines de témoignages pour sa thèse “Voix du pouvoir, voix de l’intime. Les journaux personnels du siège de Leningrad (1941-1944)”. Dans ces récits, elle a pu constater le poids de la famine et mis en lumière “une catastrophe humanitaire sans précédent”. “Les normes de rationnement ont atteint, durant l’hiver 1941-1942, une portion quotidienne de 125 grammes de pain pour la plupart des Léningradois, sachant qu’il s’agissait généralement de la seule nourriture à laquelle ils avaient droit, et que le pain était composé d’ersatz (tels que la cellulose) peu nutritifs”, raconte-elle. “Les rations allouées par le système d’approvisionnement officiel ne permettant guère la survie, les Léningradois ont eu à déployer toute leur énergie dans la quête de moyens de subsistance, repoussant, pour certains, les limites du comestible.”

Des faits de cannibalisme sont rapportés. Comme l’écrit Pierre Vallaud dans son ouvrage, dans les six mois qui suivent la fin de l’année 1941, la police arrête environ 2 000 personnes pour avoir consommé de la chair humaine. La faim devient l’unique obsession. Les files d’attente sont interminables. Tous les animaux y passent, la colle des papiers peints, le cuir bouilli ou encore les cosmétiques. Beaucoup finissent par renoncer. Les cadavres jonchent les rues. “Il est si simple de mourir aujourd’hui ! On commence par se désintéresser de tout, puis on s’étend sur son lit et on ne se relève plus jamais”, a écrit Elena Skriabina dans son journal. “C’est la famine qui est responsable de la mort de masse de la population. Le bilan reste encore difficile à établir, mais les historiens s’accordent sur près d’un million de personnes (civiles pour l’essentiel) qui ont péri durant le siège – principalement de faim et durant le premier hiver. La ville comptait, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, un peu plus de 3 millions d’habitants”, résume Sarah Gruszka.
La résistance culturelle
Les habitants de Leningrad endurent également d’autres épreuves, comme l’énumère l’historienne : “L’isolement, l’obscurité, le froid, le pilonnage allemand, le contexte répressif stalinien, l’absence d’eau courante et la nécessité d’aller la puiser en forant la glace du fleuve Neva, les maladies, les cadences éreintantes au travail, les kilomètres à parcourir en l’absence de transport, etc.”
Malgré ces conditions apocalyptiques, la vie quotidienne et notamment culturelle continue. Les bibliothèques, théâtres et salles de concert sont ouverts par intermittence. Dmitri Chostakovitch – dont Leningrad est la ville natale – écrit sa célèbre Symphonie n° 7, qui est jouée à la Philharmonie de la ville assiégée, en août 1942, par des musiciens passablement affaiblis. “J’ai voulu écrire une œuvre sur les hommes de chez nous, qui deviendront des héros dans le combat qu’ils livrent à l’ennemi au nom de la victoire”, exhorte le compositeur dans un article de la Pravda.

La lutte des artistes contre le fascisme devient aussi un outil de propagande. “La dimension culturelle de la vie dans Leningrad assiégée fait partie de ces aspects sur lesquels le pouvoir local a mis l’accent”, souligne ainsi Sarah Gruszka. “Comme dans la plupart des situations de crise militaire et politique, les autorités de Leningrad se sont efforcées de masquer l’ampleur des difficultés dans lesquelles se sont retrouvés les habitants, pour diverses raisons : parce qu’il fallait les mobiliser, en évitant qu’ils ne soient pris de panique ou d’abattement, et parce qu’ils ne devaient surtout pas remettre en cause la capacité du pouvoir à protéger et à nourrir ses citoyens.” Le contrôle de la population est toujours omniprésent. Les agents du NKVD, la police politique soviétique, ne cessent pas leur répression et sanctionnent les défaitistes. Les exécutions se poursuivent.
Un long oubli
Mais la population tient. En janvier 1943, la situation s’améliore grâce à une contre-offensive. Le verrou de Leningrad saute, un couloir terrestre est enfin ouvert et permet un meilleur ravitaillement de la ville. Mais il faut encore attendre un an avant que la cité de Pierre le Grand ne soit enfin libérée, après un siège de près de 900 jours. Le 27 janvier 1944, les Allemands sont définitivement repoussés. Le blocus est levé. L’héroïsme des habitants est alors exalté, avant d’être finalement étouffé. Le leader soviétique ne veut pas qu’on lui fasse de l’ombre. “Leningrad était la ville de la Révolution où Staline n’avait pas vraiment brillé”, analyse Pierre Vallaud. “Il n’avait pas non plus du tout envie qu’on gratte trop et qu’on se rende compte qu’il y avait eu un million de morts et qu’elle avait surtout résisté grâce au courage de ses habitants.”
Il faut attendre la fin des années 1970 pour que des témoignages émergent et offrent une version plus centrée sur les souffrances de la population. De nos jours, Sarah Gruszka note à la fois “un regain du culte de la ‘Grande Guerre patriotique’ et une ingérence du pouvoir dans l’écriture de l’histoire nationale”, tout en observant au sein de la population “une vision des choses beaucoup plus nuancée et critique, souvent davantage portée sur la dimension traumatique”.
Résultat, des commémorations officielles à “la tonalité militaro-héroïque” côtoient des initiatives privées centrées sur le recueillement et l’hommage aux victimes du siège. Certaines d’entre elles se déroulent dans le cimetière de Piskarevskoïe où ont été enterrés 470 000 civils et 50 000 combattants morts lors du blocus de Leningrad. En son centre s’élève une statue monumentale représentant “la Mère-Patrie” sur laquelle sont gravés les vers de la poétesse Olga Bergholz, rescapée du siège : “Ici reposent ceux de Leningrad, ici reposent les hommes, les femmes et les enfants de la ville, et à côté d’eux, les soldats de l’Armée rouge. Au prix de leur vie, ils t’ont défendue, Leningrad, berceau de la Révolution. Nous ne pouvons pas ici énumérer leurs nobles. Ils sont tant sous la protection éternelle du granit. Mais sache, toi qui regardes ces pierres, que personne n’est oublié, que rien n’est oublié.”