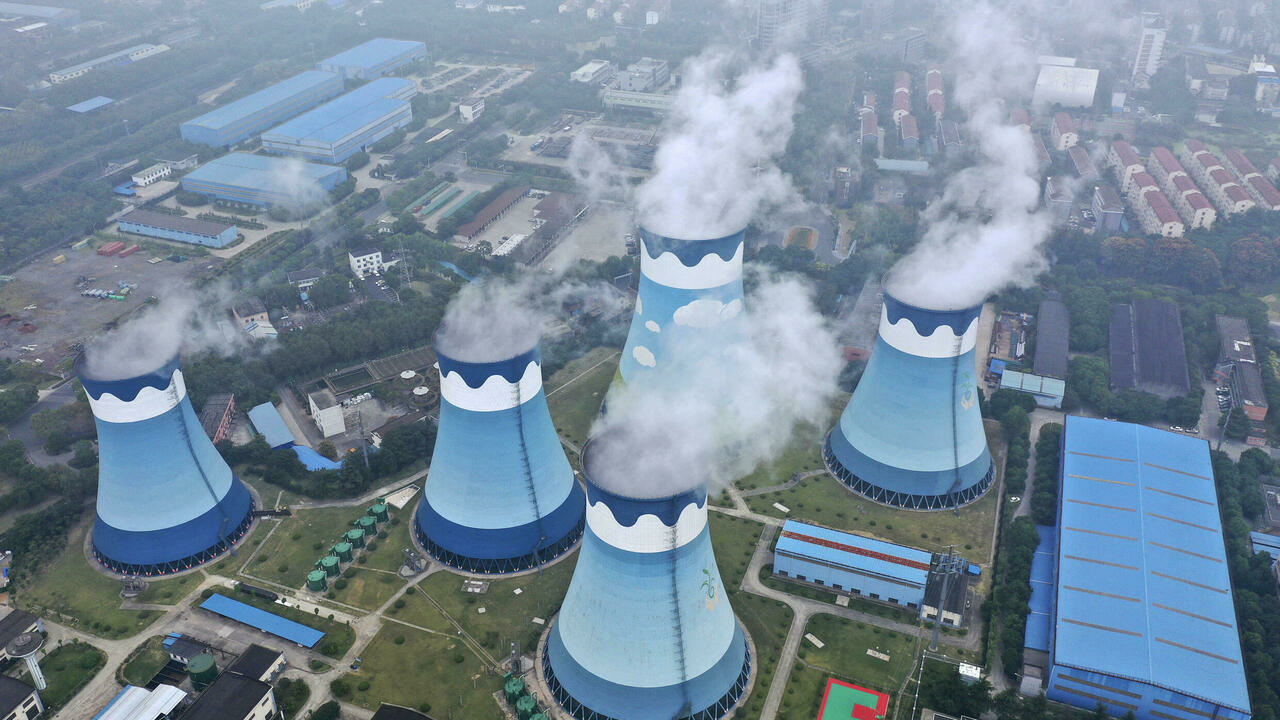Noam est policier, Célia est chirurgienne. Tous deux ont vécu ces attaques du 13-Novembre à Paris et à Saint-Denis. Pour France 24, ils ont accepté de raconter comment ces attentats ont marqué leur parcours et comment ils ont décidé d’aller de l’avant.
Le 13 novembre 2015, Paris était frappée par des attentats jihadistes faisant 130 morts et 350 blessés à l’extérieur du Stade de France, sur des terrasses de la capitale et dans la salle de spectacle du Bataclan, située dans le 11e arrondissement.
Six ans après, la justice replonge, à partir du 8 septembre et pour près de neuf mois, dans l’horreur de ces attaques, les plus meurtrières perpétrées sur le sol français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Si cette nuit du 13-Novembre a bouleversé le destin des nombreux blessés et des proches des victimes, ces attentats ont aussi laissé des traces chez les Parisiens rencontrés par France 24. Ils racontent comment ils sont allés de l’avant.
- Noam, policier près de Paris : “Ces événements tragiques m’ont fait prendre conscience à quel point la vie est précieuse et fragile. […] Je ne veux plus travailler dans la police.”

Noam n’avait pas prévu de travailler le soir du 13 novembre 2015. Installé chez lui dans son canapé, le brigadier de 45 ans de la DRPP (direction du renseignement de la Préfecture de police) regarde le match amical France-Allemagne et jette de temps en temps un œil distrait sur les réseaux sociaux comme il aime le faire. Très vite, il s’aperçoit que quelque chose se passe en consultant son compte Twitter. “Ça commençait à s’emballer.” Ses inquiétudes sont vite confirmées par un coup de téléphone. “Un collègue m’appelle pour me dire qu’une bombe a explosé aux abords du Stade de France sans savoir s’il s’agissait ou non de terrorisme. Comme je travaillais sur l’antiterrorisme, mes collègues m’ont demandé si je pouvais leur prêter main-forte.” Sans hésiter, Noam enfourche son scooter. Pendant le trajet, une deuxième bombe explose. En arrivant sur les lieux, il entend une troisième déflagration devant le McDonald’s.
Au côté du préfet, il entre dans le café Events et découvre hébété la scène de crime. “J’étais sonné, personne n’a jamais vu ce genre de scène avant.” Ce qu’il croit d’abord être des restes de viande sur les tables du restaurant sont en fait les lambeaux du corps du kamikaze. Le choc. Toujours accompagné du préfet qui garde son sang-froid, il décide de calquer son attitude sur la sienne. “Je me suis dit que ce n’était pas le moment de me laisser envahir par mes émotions. Je me suis bloqué et j’ai fait mon travail.” À côté du restaurant, il retrouve le passeport syrien du terroriste, qui s’avérera plus tard être un faux. Il accompagne le préfet pour assurer sa sécurité et demande à ce que l’on effectue le relevé des plaques de toutes les voitures du quartier. Puis il commence à recevoir des appels de personnes qui souhaitent avoir des informations sur leurs proches qui se trouvaient au Bataclan. “En les écoutant, je me suis retrouvé désemparé, j’avais vraiment de la peine.” Le policier cesse de répondre aux appels des numéros qu’il ne connaît pas. “Je ne voulais pas endosser une lourde responsabilité et devoir annoncer de terribles nouvelles.”
Quelques semaines après les événements, le dépit et la colère dominent. “Je me dis que l’on est passé à côté, qu’avec des moyens matériels et financiers, le drame aurait pu être évité. Les outils de la police sont inefficaces et obsolètes.” Son amertume grandit encore quand il découvre qu’il avait lui-même rédigé la fiche de Samy Amimour, l’un des auteurs des attentats. “Il était juste sous contrôle judiciaire alors qu’il aurait dû être incarcéré.” À cette époque, il y avait encore “trop de stress pour faire le bilan”. Mais depuis, le policier a fini par panser les plaies de cette nuit d’horreur. “Ces événements tragiques m’ont fait prendre conscience à quel point la vie est précieuse et fragile. J’ai compris que je ne voulais plus travailler dans la police : être fonctionnaire au sein de la DGSI ne sert malheureusement pas à grand-chose si ce n’est être une cible.”
Le fonctionnaire de police a aussi ressenti une fracture s’opérer chez quelques collègues après les attentats. “Certains d’entre eux m’ont dit qu’ils n’avaient plus confiance en moi parce que j’étais musulman. J’ai toujours été loyal, patriote mais je ne voulais plus avoir à me justifier, alors j’ai préféré quitter la police.”
Depuis, Noam a pris du temps pour réfléchir. Il veut désormais se consacrer à l’enseignement pour transmettre ce qu’il a appris. Il s’est récemment tourné vers le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, pour mettre à profit ses connaissances sur le terrorisme. Ses aspirations le portent également vers l’écriture. Il travaille d’ailleurs à la rédaction d’un nouvel ouvrage sur les questions de sécurité. “Maintenant, je veux vivre une vie paisible.”
- Célia, chirurgienne : “C’est quelque chose qui fera toujours partie de ma vie. Je sais que je peux être utile dans ces cas-là.”

Ce soir-là, Célia, enceinte de quelques mois, est installée en pyjama aux côtés de son compagnon devant un bon film. Très vite, la jeune femme est alertée par les SMS incessants de sa famille et elle prend conscience de ce qu’il se passe. À 33 ans, chirurgienne vasculaire, elle est alors cheffe de clinique à Bichat. Ni une ni deux, elle appelle ses collègues pour venir soigner les blessés. Tout ce qu’elle demande, c’est d’être conduite en sécurité jusqu’à l’hôpital, car dehors la tuerie continue au Bataclan et les tireurs des terrasses sont en fuite. “Une voiture de police est venue escorter mon taxi, comme on le fait lorsqu’on transporte des poumons pour une greffe.” Ce qui l’attend à l’hôpital Saint-Louis, où sont acheminés de nombreux blessés cette nuit-là, est inimaginable. “Une vraie scène de guerre”, se souvient-elle.
Les blessures par balles, elle connaît déjà. Son métier, c’est de réparer les vaisseaux sanguins, elle est donc amenée à intervenir sur des traumatismes très graves. Mais ce qui touche le plus la chirurgienne, c’est le “silence” qui règne dans la salle de réanimation et le “regard vide” de ses patients. “Ils ne disaient plus rien, ils étaient sous le choc, ils venaient d’être attaqués avec une violence inouïe à un moment où ils n’avaient pas du tout envisagé ça, un verre à la main avec leurs amis en terrasse. Je me souviens d’une jeune femme avec des plaies majeures qui semblait comme détachée de son corps, comme si elle n’avait plus rien à perdre ou comme si elle l’avait déjà perdu.”
Toute la nuit, Cécile travaille d’arrache-pied. Au petit matin, elle sort de l’hôpital abasourdie et se console en regardant le soleil se lever. Six mois plus tard, des scènes lui reviennent pendant son congé maternité. “Je faisais beaucoup de cauchemars”, raconte-t-elle. “Je crois, avec le recul, que j’ai absorbé beaucoup de choses et je pense avoir eu un syndrome post-traumatique”, confie-t-elle. Célia écrit pour tout faire sortir.
Des patients soignés cette nuit-là, elle garde en mémoire un sportif de haut niveau dont la carrière a été brisée par la balle ayant perforé son poumon. “Il a écrit un livre, je l’ai acheté, ça m’a permis d’avoir de ses nouvelles.”
“C’est quelque chose qui fera toujours partie de ma vie. (…) Je sais que je peux être utile dans ces cas-là”, répète-t-elle en repensant à cette interminable nuit, fière d’avoir pu aider en “gardant son sang-froid”. Aujourd’hui, elle travaille en Savoie, loin de Paris. Elle qui se destinait avant ce drame à une carrière dans l’humanitaire, sur des zones de guerre, a changé d’avis après avoir côtoyé “l’horreur”. Même si elle n’exclut pas de mettre son savoir au service des autres si cela se représente. “Si c’était à refaire, je le referais sans hésiter.”
>> Retrouvez les témoignages de Bart, directeur de La Belle équipe, Jean-Baptiste, enseignant à Paris, et Nicolas, agent immobilier.