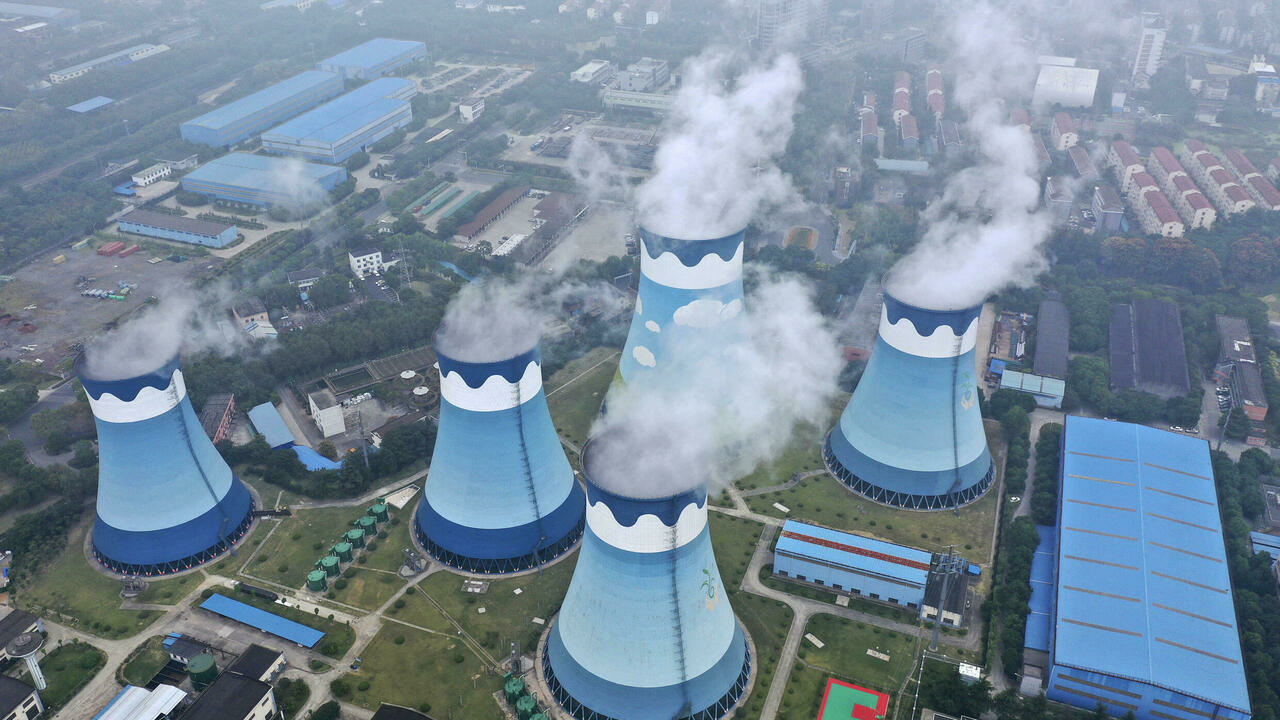Le scandale de la démonstration d’un viol en direct à la télévision a relancé le débat autour de la question des violences sexuelles. Les collectifs et associations féministes veulent y voir le signe d’un tournant dans la lutte contre ce fléau.
L’indignation ne retombe pas en Côte d’Ivoire. Depuis près d’une semaine, les réseaux sociaux s’enflamment pour dénoncer la banalisation de la culture du viol dans le pays. Mercredi 1er septembre, plusieurs dizaines de militantes féministes ont également manifesté devant le siège de la chaîne privée NCI pour réclamer des sanctions.
L’objet de leur colère : une séquence sordide d’une émission de divertissement dans laquelle un ancien violeur était invité à simuler une agression sexuelle sur un mannequin en plastique puis à prodiguer des conseils aux femmes pour éviter de subir le même sort.
Devant le tollé général, la justice s’est saisie de l’affaire avec une inhabituelle rapidité et l’animateur Yves de M’Bella a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 3 000 euros pour “apologie du viol”.
Quant au diffuseur, il n’a pour le moment pas été poursuivi, la Haute Autorité de communication audiovisuelle (Haca) se contentant de l’inciter à faire preuve de “vigilance” dans sa programmation. Une clémence qui fait bondir les associations féministes. Celles-ci déplorent en effet l’absence de sanctions contre la direction de la chaîne.
Ceci dit, dans cette situation, il n’est pas le seul problème. If anything, il est un symptôme du réel problème qu’est la culture du viol et c’est contreproductif de le réduire à NCI ou à Yves de M’bella
— Ruby (@Rubyjaidit) August 31, 2021
Pour autant, la forte réaction de l’opinion publique et la célérité de l’action judiciaire laissent penser que la Côte d’Ivoire vient peut-être de connaître un tournant dans la lutte contre les violences sexuelles. “On voit un signal fort, ça prouve qu’il y a des choses qu’on ne peut plus laisser passer, que le viol n’est pas toléré”, assure Désirée Dénéo, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes (LIDF), interrogée par l’AFP. “Cela ouvre le débat sur le viol dans la société ivoirienne” et “cela permet à ces femmes de ne pas se sentir seules et de pouvoir passer le cap du silence.”
Nouvelle génération
Pour les associations, cette mobilisation de la société civile est le signe que le travail de sensibilisation effectué depuis plusieurs années commence également à payer. Dans le sillage du mouvement #MeToo et #BalanceTonPorc en 2017, une nouvelle génération d’activistes, plus jeunes et connectés, a contribué à mettre sur le devant de la scène la question du genre et du sexisme ordinaire dans les sociétés traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.
“L’utilisation des réseaux sociaux par ces jeunes féministes a permis de rendre plus visibles leurs actions et de dénoncer certains comportements sans avoir à passer par l’État ou un autre pouvoir”, détaille pour France 24 la chercheuse Carolin Beck, spécialiste du genre à Sciences-Po et auteure d’une étude sur les mouvements féministes en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Cela leur offre une plate-forme pour agir de manière très libre.”
Bénédicte Joan appartient à cette nouvelle génération de femmes africaines bien décidées à faire bouger les lignes. Depuis la diffusion de l’émission, la présidente de l’association Stop au chat noir, assure auprès de France 24 recevoir 15 messages par jour. “Ce sont des jeunes qui veulent s’engager et sensibiliser les gens dans leur communauté car cela se passe aussi dans leur quartier, dans leur maison.”
Dans la culture populaire, “le chat noir” désigne un agresseur, un oncle ou un ami de la famille, qui se glisse la nuit dans la chambre d’une jeune fille pour la violer par surprise. “C’est une expression un peu humoristique que beaucoup de comédiens utilisent dans leurs sketchs. Nous, nous disons qu’il faut arrêter de rire du viol”, explique la militante. “Le problème c’est que depuis la crise post-électorale de 2010, nous vivons dans une société du divertissement, on rigole de tout et on ne prend plus rien au sérieux”.
Plusieurs études montrent que les violences sexuelles sont pourtant loin d’un sujet qui prête à rire en Côte d’Ivoire. Selon l’ONU, un quart des Ivoiriennes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commis par un proche tout au long de leur vie.
Comme dans d’autres pays, les périodes de confinement liées à l’épidémie de Covid-19 ont aussi contribué à faire grimper les violences faites aux femmes. En juin 2020, l’organisation Citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités (CPDEFM), emmenée par la juriste Sylvia Apata, a publié une étude auprès de plus de 5 500 femmes. Dans la seule ville d’Abidjan, l’association a recensé en deux ans 416 féminicides et 2 000 cas de violences faites aux femmes, dont 1290 cas de mariage de filles de moins de 18 ans et 1 121 viols.
Payer pour un certificat de viol
La Côte d’Ivoire dispose également de statistiques officielles collectées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. En 2018, les autorités ont rapporté 2 744 cas de violences basées sur le genre dont 693 viols sur l’ensemble du territoire. Mais ce chiffre serait largement sous-évalué, selon les associations, car peu d’agressions font l’objet d’une plainte et encore moins de poursuite judiciaire.
En plus de devoir surmonter les pressions sociales, le sentiment de honte ou la crainte des représailles, les victimes doivent s’acquitter de 50 000 francs CFA, soit 76 euros pour obtenir un certificat médical de viol. Un document qui, sans être obligatoire, est essentiel d’un point de vue juridique pour faire aboutir les procédures.
“Ce certificat permet d’apporter la preuve de ce que vous avez subi”, détaille sur l’antenne de France 24 Carelle Goli, responsable juridique de la Ligue qui se bat pour un meilleur accompagnement des survivantes d’agressions sexuelles. “Il faut que ce certificat devienne gratuit pour que la victime puisse porter plainte le plus tôt possible”.
De leur côté, les autorités sont bien conscientes du problème et multiplient les initiatives : campagnes de sensibilisation, plateformes d’écoute, cellules spécialisées dans les commissariats pour enregistrer les plaintes… En 2014, le gouvernement a lancé une Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et un Observatoire l’année suivante.
“Sur le papier, il y a beaucoup de bonnes idées et le pays est vraiment engagé”, analyse Carolin Beck. Sauf que la durée des financements ne permet pas toujours de mener des actions sur le long terme. Par ailleurs, les moyens sont très concentrés sur Abidjan et moins sur les zones rurales. Le cadre légal est là, maintenant il faut qu’il soit appliqué”.
“Le ministère de la Femme fait énormément d’efforts en organisant des campagnes pour prévenir les violences basées sur le genre” reconnaît Bénédicte Joan. Mais on ne peut pas demander à une société aussi peu sensibilisée de faire cent pas d’un coup. Les choses avancent mais elles avancent lentement.”