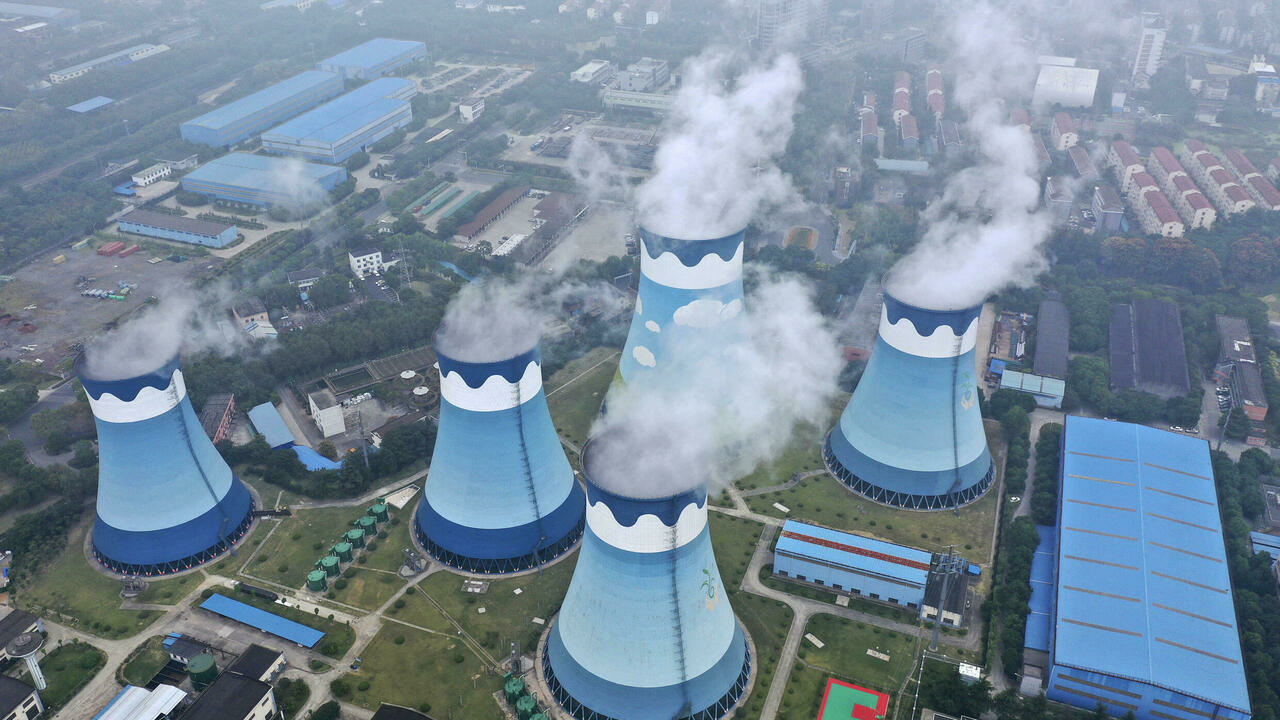Près d’un an après avoir été dévasté par les explosions du 4 août 2020, l’Hôpital Libanais Geitaoui tente de poursuivre sa mission. Une vocation mise à mal par la lente descente aux enfers du secteur médical au Liban, grevé comme l’ensemble du pays par les crises socio-économique et sanitaire.
Installés provisoirement au dernier étage de l’Hôpital Libanais Geitaoui, depuis que le secteur réservé à l’administration a été soufflé lors des explosions du 4 août 2020, les co-directeurs de l’établissement, sœur Hadia Abi Chebli, et le professeur Pierre Yared ne peuvent que se remémorer quotidiennement et visuellement cette journée meurtrière et dévastatrice.
Et pour cause : les fenêtres de leur bureau de substitution donnent directement sur l’épicentre de la tragédie. Sous leurs yeux s’étend le port de Beyrouth, ses gigantesques silos à grains éventrés et le cratère où se trouvait le hangar numéro 12, où étaient stockées les 2 750 tonnes de nitrates d’ammonium à l’origine des explosions.
L’hôpital, situé dans le quartier densément peuplé de Geitaoui, dans l’est de la capitale, avait été très sévèrement endommagé alors qu’il abritait 120 patients ce jour-là. En pleine crise sanitaire, son unité Covid-19 avait notamment été détruite.
L’établissement avait même été déclaré hors-service pour 48 heures dès le lendemain, même si les équipes médicales avaient pu traiter et opérer, dans la soirée du 4 août, des dizaines de blessés dans les rares espaces jugés suffisamment sécurisés.

“Ce jour-là, les soignants et de nombreux patients ont été touchés, nous n’avons eu que quelques minutes pour retrouver nos esprits avant qu’un flot de personnes blessées par l’explosion n’affluent, se remémore avec précision le docteur Naji Abi Rached, directeur médical de l’hôpital et chef du service de réanimation cardiaque. Nous avons dû réagir très vite, alors que les 8 étages du centre hospitalier universitaire et ses capacités logistiques avaient subi des dégâts, en utilisant toutes les zones à notre portée et en transformant le parking des urgences en espace de soins”.
Un an après le cataclysme, l’établissement, qui a une capacité de 260 lits, poursuit sa reconstruction, à l’instar des deux centres hospitaliers situés dans la même zone. “Nous avons miraculeusement pu réparer environ 80 % des dégâts en près de 8 mois, et désormais la plupart des étages sont fonctionnels, détaille le professeur Pierre Yared. Jusqu’ici, nous avons dû régler une facture de 7 millions de dollars, et ce n’est pas fini puisqu’il reste des réparations à faire, notamment dans le service des urgences et celui de l’accueil des patients”.
La somme a été financée par de nombreux acteurs – donateurs, compagnies privées, ONG, groupes internationaux et même le Vatican, tous venus au chevet de cet hôpital privé à but non-lucratif, rattaché à une institution religieuse, la Congrégation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille.
“Nous n’avons reçu aucun centime de la part de l’État libanais alors que des commissions avaient été envoyées pour évaluer les dégâts, mais nous n’avons plus eu de leurs nouvelles, même un an après l’explosion”, ironise le professeur Pierre Yared, spécialiste de chirurgie viscérale, alors que le coût total des dégâts de l’hôpital est estimé à 15 millions de dollars.
La direction espère rouvrir l’ensemble des départements de l’hôpital fin septembre et ainsi lui permettre de retrouver 100 % de ses capacités.
“Je lance un appel au secours, un SOS”
Mais le temps des réparations, le Liban a continué à s’enfoncer dans les multiples crises qui plombent le pays depuis deux ans et dont les conséquences sont venues se greffer à celles des explosions du 4 août. Ces crises, qui donnent chaque jour des sueurs froides aux deux co-directeurs de l’Hôpital Libanais Geitaoui, sont liées à la désastreuse situation économique du pays du Cèdre et à la chute vertigineuse de sa monnaie qui poussent médecins et infirmières, à l’instar de nombreux Libanais, à partir à l’étranger.

“Je lance un appel au secours, un SOS, aux pays européens, et surtout à la France, qui représente notre espace culturel et francophone, pour nous aider à stopper cette hémorragie qui va nous coûter très cher, dit le professeur d’un air grave. Car il ne sert à rien d’avoir un hôpital disposant des meilleurs équipements s’il n’y a plus de médecins pour les utiliser”.
De son côté, sœur Hadia Abi Chebli, infirmière de formation, appelle à la résistance face à ce qu’elle qualifie d’ “exode”. L’hôpital Geitaoui n’échappe pas au phénomène : 30 soignants qui y travaillaient sont partis à l’étranger au cours des deux dernières années. “Il ne faut pas quitter, il faut résister, le Liban est notre pays, à qui va-t-on le laisser ? Il faut tenir bon !”
Depuis son fief de l’unité de soins cardiaques, qui avait elle aussi été détruite en quelques secondes par les explosions, le docteur Naji Abi Rached a répondu à cet appel à la résistance, même s’il ne cache pas son désarroi face à la situation.
“Malheureusement, les départs vont crescendo, puisque plus de 1 000 médecins ont déjà quitté le Liban et autour de 1 500 demandent à partir, déplore le cardiologue, tout en gardant l’œil sur un patient à peine réveillé, dans une des chambres restaurées de l’unité. Ces professionnels de santé font partie de l’élite des médecins et sont en train de prendre le chemin de l’Europe et des pays du Golfe parce qu’ils offrent des perspectives attractives”.

Le coup est rude pour le secteur médical libanais, alors que le pays était qualifié d’ “hôpital du monde arabe” pour la qualité réputée de ses services médicaux, mais aussi la renommée de ses médecins. Ces derniers sont formés localement à l’Université américaine de Beyrouth et la Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph, avant de partir se spécialiser à l’étranger, notamment en France et aux États-Unis.
“Malgré la crise économique, l’instabilité politique et l’absence de perspectives d’avenir, il y a quand même des médecins qui doivent rester, parce qu’on ne peut pas tous abandonner le bateau, poursuit le docteur Naji Abi Rached, qui a fait sa spécialisation en France. J’ai moi-même choisi de rester parce que j’ai des responsabilités et parce que je garde l’espoir de retrouver un Liban meilleur”.
Un futur auquel ne semble déjà plus croire, à 29 ans, le docteur Patrice Nasas, résident en troisième année en médecine interne, venu prendre des nouvelles d’un patient dans l’unité de soins cardiaques. “J’avais beaucoup d’espoirs pour le Liban, mais dans le contexte actuel, je pense à partir aux États-Unis, alors que je n’aime pas l’idée de quitter mon pays, confesse-t-il. Je connais personnellement beaucoup de personnes du secteur qui ont franchi le pas et qui sont déjà parties, qu’ils soient étudiants en médecine, docteurs établis, ou infirmières”.
Avec la crise de la monnaie, le salaire en livres libanaises de Patrice Nasas équivaut à tout juste 65 dollars par mois, selon les taux du marché noir (1 dollar pour 18 000 livres ces derniers jours, contre 1 dollar pour 1 500, selon le taux officiel), alors qu’avant la crise il oscillait entre 800 et 900 dollars.

“Pour s’en sortir, ajoute-t-il, certains soignants essayent de cumuler deux emplois, en prenant des gardes dans un hôpital et qui acceptent d’autres gardes non-officielles dans un autre établissement, d’autres demandent de l’aide à leurs parents, eux-mêmes fragilisés financièrement puisque que la situation devient difficile pour tout le monde”.
“Parfois, je ne sais vraiment plus quoi dire aux patients”
Zélia Francis, docteur et chef de service d’endocrinologie de l’hôpital, qui a vécu et suivi une partie de ses études à Paris dans les années 2000, pense, elle aussi, à quitter le pays. “J’ai très envie de rester dans mon pays qui passe par une période difficile, que j’espère transitoire, et je suis encore là juste pour assurer une continuité à mes malades, mais honnêtement, si les choses ne changent pas et si l’on ne voit pas de lueur d’espoir, c’est vrai qu’il est très tentant de partir”.
Elle dit se sentir parfois désemparée et impuissante face à ses patients à mesure de l’aggravation de la situation. “Alors que de nombreux médicaments ne sont plus disponibles dans le pays, nous avons reçu, il y a quelques jours, une alerte sur les stocks d’insuline qui se réduisent, confie-t-elle en serrant dans sa main son téléphone portable. De mon côté, je reçois tous les jours des centaines d’appels de patients me demandant de leur prescrire des traitements de substitution, alors que je sais que ceux-ci ne sont plus disponibles depuis quelques semaines et que personne ne réagit”.
Et de soupirer : “C’est une situation très compliquée à gérer psychologiquement, même si l’on a essayé de trouver des solutions temporaires, mais la crise devient de plus en plus aigüe au point que je ne sais vraiment plus quoi dire aux patients”.

Les pénuries de médicaments et de matériels risquent de se multiplier dans les prochaines semaines, faute de devises étrangères, précisément de dollars américains nécessaires pour les importations.
“Un orthopédiste me disait récemment qu’il allait être obligé d’opérer de jeunes patients, bien qu’il ne dispose pas de prothèse de hanche à la taille de cette tranche d’âge, confiait plus tôt le professeur Pierre Yared. Il est impossible de planifier l’achat de matériel en raison de la flambée des prix, des pénuries et du manque de transparence dans la gestion de la crise par la Banque du Liban, le ministère de la Santé et les fournisseurs de matériels et de médicaments”.
Au cours du mois de juin, le syndicat des propriétaires d’hôpitaux privés avait prévenu que les établissements hospitaliers pourraient se trouver dans l’incapacité d’administrer certains traitements, notamment des hémodialyses. Pour sa part, l’Hôpital Libanais Geitaoui a trouvé une solution temporaire.
“Un donateur a répondu à un appel qu’on avait lancé et sa générosité nous permettra d’assurer à nos patients des dialyses pendant les trois prochains mois, certifie la co-directrice de l’établissement, sœur Hadia Abi Chebli. Mais nous ne savons pas ce qui se passera après cette date car c’est une crise que l’on gère, au jour le jour et au cas par cas”.
En réaction à l’aggravation de la crise économique et aux pénuries, l’hôpital a récemment inauguré un dispensaire afin d’assurer des soins de santé primaires aux plus démunis pour un prix symbolique, avec l’aide de plusieurs ONG, du ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé.
“Nous avons réfléchi à l’installation de ce centre après l’explosion au port de Beyrouth, la dégradation de la situation socio-économique du pays et la paupérisation de la population, précise le docteur Naji Abi Rached, venu échanger avec l’équipe du dispensaire, situé dans un bâtiment à quelques pas de l’hôpital. Nous y recevons de plus en plus de monde et nous nous attendons à une explosion de la demande vu la situation actuelle et des pénuries”.
Et selon lui, tous les scénarios doivent être désormais envisagés. Non seulement en raison des pénuries qui posent des problèmes et des départs à l’étranger, mais aussi pour des questions de simple logistique, alors que l’électricité fournie par l’État est rationnée et qu’il est difficile de se ravitailler en fioul pour faire fonctionner les générateurs de l’hôpital.
“Dans ce cas de problèmes logistiques, la capacité d’accueil ne sera plus la même face à une éventuelle nouvelle vague de Covid-19, et la situation peut encore s’aggraver s’il n’y a pas de solution proposée par l’État, conclut-il. Or nous voyons que les dirigeants n’ont pas beaucoup de réactions vis-à-vis de cette crise et c’est pour cela que nous nous attendons au pire : c’est-à-dire à l’écroulement total du secteur sanitaire au Liban, qui mènerait au scénario catastrophe et à une crise humanitaire”.