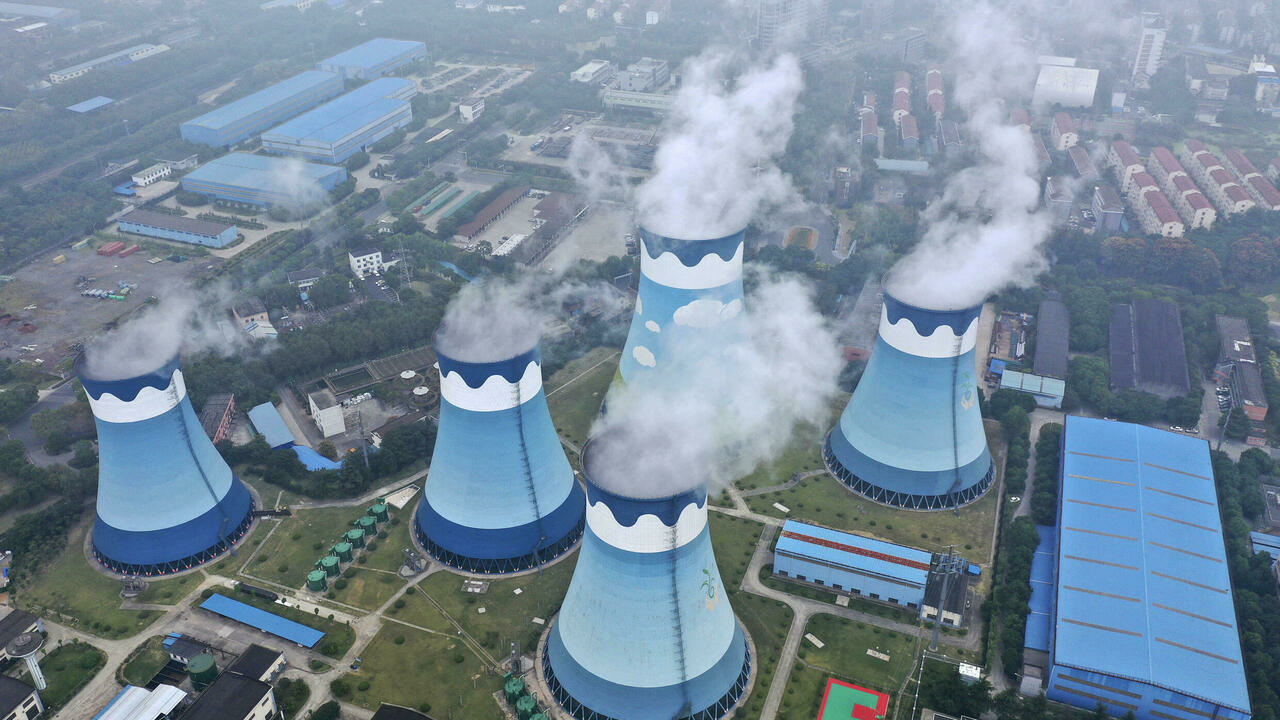À l’écran, comme dans la vraie vie. Jeudi, la guerre, la censure, les combats politiques étaient les sujets centraux de plusieurs films projetés à Cannes. Des thématiques qui résonnent fort cette année, alors que le président du jury, Spike Lee, a placé le festival sous le signe de la lutte.
Cela pourrait s’appeler “la malédiction d’Alain Resnais”. Le réalisateur français, mort en 2014, a eu une histoire mouvementée avec le Festival de Cannes. Après des années à voir ses œuvres censurées sous la pression politique, ce n’est qu’à la fin de sa carrière qu’il pu être applaudi sur la Croisette.
En 1957, son documentaire “Nuit et Brouillard”, une des premières réflexions cinématographiques sur l’Holocauste, est ainsi retiré de la liste des films sélectionnés pour le festival à la demande du gouvernement allemand. L’argument avancé : un tel film risque de mettre à mal le processus de réconciliation franco-allemande. La France avait pourtant déjà fait retirer une scène mettant en lumière la collaboration.
Deux ans après, Alain Resnais retente sa chance avec son sublime “Hiroshima, mon amour”, peut-être l’un des plus grands films de guerre –et de paix – jamais réalisé. Le film subit le même sort, cette fois-ci à cause du gouvernement américain. Troisième tentative en 1966 avec “La guerre est finie”, qui raconte l’histoire de réfugiés espagnols. Là encore, le film n’est pas projeté sous la pression du gouvernement Franco.
Cinquante-cinq ans plus tard, le réalisateur a enfin eu sa revanche. Jeudi 8 juillet, “La guerre est finie” a été projeté dans la catégorie des “Cannes classiques” du festival, qui présente des films de cinéastes considérés comme cultes.
Une guerre qui n’en finit pasJeudi, le festival a été marqué par le film de guerre d’un autre réalisateur français, “Onoda, 10 000 nuits dans la jungle” d’Arthur Harari, présenté dans la section “Un certain regard.”
Le film relate la vie d’Hiro Onoda, figure emblématique de l’histoire japonaise qui a continué à se battre pendant trente ans dans la jungle aux Philippines, refusant de croire que la guerre était finie après la capitulation japonaise de 1945. Trois heures de camaraderie, de solitude, et l’histoire d’un soldat qui a préféré le déni à la réalité, sombrant peu à peu dans la folie. Sans nul doute, ce sera l’une des œuvres phares de ce festival.
Le récit démarre en 1974. Onoda tombe nez à nez avec un touriste japonais à la recherche d’un “panda géant et du Yéti, dans cet ordre”. Puis, un bond dans le temps ramène le spectateur plusieurs années en arrière, dans le camp d’entraînement qui a formé ce soldat prêt à tout pour son empereur. Héros ou antihéros, le film ne tranchera jamais la question.
‘Agent orange’
La guerre, la lutte : ces deux thèmes résonnent particulièrement fort cette année, dans un Festival de Cannes éminemment politique porté par le président du jury, Spike Lee, premier réalisateur noir à occuper ce poste.
“Ce monde est dirigé par des gangsters”, a-t-il déploré dès la conférence de presse d’ouverture du festival, dénonçant pêle-mêle, avec les autres membres du jury, la politique de Poutine et Bolsonaro, ou les discriminations raciales et de genre. Il n’a par ailleurs pas hésité à surnommer l’ancien président américain Donald Trump, “Agent orange”.
Le réalisateur répondait à une journaliste géorgienne, qui a pris la parole pour s’alarmer de la situation des LGBT en Géorgie, où la Marche des fiertés a dû être annulée lundi après des échauffourées déclenchées la veille par des groupes hostiles, une question que la plupart des membres du jury ont reconnu découvrir, tout en lui apportant son soutien.
Le cinéaste new-yorkais portait une casquette noire siglée “1619” sur la tête, en référence à l’année d’arrivée des premiers esclaves aux États-Unis. Il est revenu sur le sort des Noirs dans le pays, un thème qu’il n’a jamais cessé d’explorer dans ses films, notamment “Do the Right Thing”. Plus de “trente putains d’années après” ce film, “on aurait pu croire que les personnes noires auraient arrêté d’être traquées comme des animaux”, a-t-il déclaré, avant de faire référence aux Noirs victimes de violences policières comme “le frère Eric Gardner” ou “le roi George Floyd”, qui ont été “tués, lynchés”, a-t-il ajouté.

D’autres membres du jury se sont faits militants lors de cette conférence de presse, comme le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, qui a critiqué la politique de son gouvernement son “mépris pour la culture” et une “censure”. Il a notamment accusé le gouvernement Bolsonaro d’avoir fermé la cinémathèque nationale.
“La censure de l’intérieur”
La censure est d’ailleurs le thème central d’un autre film présenté à Cannes cette année, “Le Genou d’Ahed” du cinéaste israélien Nadav Lapid.

Comme “Synonymes”, film inspiré de sa propre expérience sur un jeune homme qui déménage à Paris en tentant de cacher son origine israélienne, Ours d’or à Berlin en 2019, “Le Genou d’Ahed” est en partie autobiographique.
Le long-métrage raconte l’histoire d’un réalisateur israélien de 46 ans invité par un membre du gouvernement à présenter son dernier film dans un village éloigné, dans le désert. À son arrivée, on lui demande de signer un formulaire dans lequel il s’engage à n’aborder qu’une liste restreinte de sujets.
“Ce qui est triste en Israël, c’est qu’il n’y a pas besoin de mettre des tanks en face de l’Israeli Film Fund (le fonds chargé de soutenir le cinéma israélien, NDLR), il n’y a pas besoin d’arrêter un réalisateur et de le jeter en prison comme en Russie”, a expliqué le cinéaste dans une interview à l’AFP. “Il suffit juste de dire ‘assez parlé de politique les gars, parlons juste famille’.”
“Ce qui m’ennuie”, c’est “quand la censure devient une partie de votre âme, de votre esprit”, qu’elle vient “de l’intérieur. Elle vous accompagne comme une ombre”, poursuit-il.
Traduit de l’original en anglais par Cyrielle Cabot.